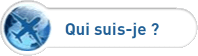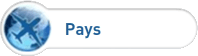Revoir le globe

|
Autour du Lac du Bourget
(Savoie, France) |
|
Lundi 23 septembre 2019
La Savoie offre le plus grand lac naturel d'origine glaciaire entièrement situé en France, le Lac du Bourget, autour duquel j'ai choisi de me promener aujourd'hui. Celui-ci fut formé à l'issue de la dernière glaciation de Würm, il y a près de 19000 ans de cela, suite au retrait d'un grand glacier alpin du quaternaire. Son nom actuel est lié à la commune qui borde sa partie méridionale, Le Bourget du Lac, mais également au poète Alphonse de Lamartine qui y écrira des poèmes, dont un, « Le Lac » qu'il dédiera à la femme qu'il aime, Julie Charles, lors de son séjour d'octobre 1816.
Surveillant du coin de l'oeil la météo, je préfère me diriger de suite vers le Belvédère de la Chambotte, de crainte que le temps ne se couvre et ne gâche ma séance photos. Je programme Saint Germain la Chambotte sur mon GPS et c'est parti ! Ce village, situé sur la route du col de la Chambotte, est majoritairement boisé et la route, qui me mènera jusqu'au belvédère, pleine de lacets. N'empêche que cette route fut jadis une voie romaine et vit, dit-on, passer les troupes d'Hannibal. Le paysage, lui, offre vignes et figuiers particulièrement adaptés au climat sec de ce côté de la montagne. L'endroit connaitra ses heures de gloire à la fin du 19è siècle lorsque des personnages illustres comme Félix Faure ou Jules Ferry, alors en cure à Aix les Bains, grimperont jusqu'au belvédère de Louis Lansard et de son épouse. Même la reine Victoria fera le déplacement le 16 avril 1887. Suivront Paul Deschanel en 1910, puis l'écrivain Pierre Loti, dix ans plus tard. Après un tel défilé de personnalités, je ne pouvais moi-même déroger à la règle. J'avoue que trouver une place où garer mon véhicule ne sera pas chose facile. Puis, mon regard croisera celui d'une jeune femme chinoise. Nous échangerons quelques mots et elle me confiera attendre la venue de l'ambassadeur de Chine en France d'une minute à l'autre. La délégation arrivera effectivement dix minutes plus tard. Ce que je ne savais pas, c'est que le Belvédère de la Chambotte est aussi un restaurant à la vue imprenable où il est possible de déguster l'une des spécialités culinaires du village en contrebas, à savoir la Tomme de Savoie ou Coeur de Savoie. Jamais bien loin, le vin de Savoie est quant à lui produit près d'ici, au hameau de Challières. A mon arrivée, plusieurs clients sont déjà attablés face au lac du Bourget. Je demande au personnel l'autorisation de prendre des clichés, permission aussitôt accordée. Le paysage est grandiose (ci-dessous) et la lumière parfaite en ce milieu de journée. Dire que non loin de là, certains courageux s'exercent à l'escalade sur les falaises de Chambotte....
D'une superficie de 4450 hectares, le lac du Bourget s'étire sur 18 km (et sur une largeur de près de trois kilomètres) et atteint une profondeur de 85 à 145 mètres. Cette étendue d'eau contribue à adoucir le climat semi-continental qui prévaut ici. Ainsi, les températures ne dépassent jamais les 35°C même lors d'épisodes caniculaires. Je conduis prudemment sur cette route étroite qui me mène jusqu'à Chindrieux, l'occasion pour moi d'admirer la vue superbe sur cette petite commune (ci-dessous). Ma prochaine étape me conduit à Chanaz, ravissant petit village surnommé « la petite Venise savoyarde » en raison de la présence du canal de Savières (deuxième photo ci-dessous). Labellisée Petite Cité de caractère, cette commune a fort à faire avec le déferlement touristique en haute saison et a pris le parti de réglementer la circulation automobile dans ses rues. Il est difficile de se garer sans disque bleu (je n'en dispose malheureusement pas cette fois dans ma boite à gants!) et je serai contraint de me réfugier sur le parking du petit supermarché local. Outre le canal, la raison de ma venue à Chanaz est son moulin à huile : au 19è siècle, Chanaz abritait trois moulins. Celui qui nous intéresse produisait à l'origine de la farine, puis de l'huile de noix à partir de 1946. Et de suspendre toute activité plus de quarante années, avant que la commune ne reprenne la main sur ce vieil outil en 1995. Restauré dans les règles de l'art, le petit moulin de 60m2 est équipé d'une roue à augets qui lui fournissait autrefois l'énergie indispensable à son activité. Au premier étage du bâtiment se trouvent encore les meules en pierre qui étaient utilisées pour produire la farine, tandis que le rez-de-chaussée abrite le moulin à huile de noix. Une meule en pierre écrase les cerneaux de noix, ou les amandons de noisettes qui se transforment en pâte. Cette pâte est ensuite déshydratée puis enveloppée dans un tissu (scourtin) avant d'être placée dans la presse hydraulique pour en extraire une huile de première pression à froid. Les particuliers peuvent ainsi apporter leurs cerneaux de noix ou leurs amandons de noisettes, puis repartir avec leur huile.
Partons maintenant en direction de l'Abbaye de Hautecombe (ci-dessous). Cet ancien monastère cistercien est le joyau d'une rive lacustre restée sauvage. L'endroit, fondé en 1139, est desservi par une petite route isolée et possède son vignoble qui offre un vin local, le Royal Hautecombe, en vente à la boutique. L'abbaye connaitra son âge d'or aux 13è et 14 siècle en jouissant à cette époque d'une grande puissance séculière et d'un intense rayonnement spirituel. Puis la Révolution française passa par là et l'institution fut momentanément transformée en faÏencerie, avant d'être occupée à nouveau par les Cisterciens, puis par les Bénédictins (face à l'affluence des visiteurs, cet ordre quittera l'abbaye pour en rejoindre une autre, plus propice à la solitude, celle de Notre-Dame de Ganagobie) jusqu'à l'installation en 1992 d'une communauté catholique oecuménique d'une quarantaine de personnes, celle du Chemin neuf. L'abbaye fut jadis choisie par la dynastie de Savoie comme lieu de sépulture : l'Abbaye de Hautecombe abrite ainsi les sépultures de la famille de Savoie et celles des derniers rois et reines d'Italie, inhumés en 1983 et 2001. Plus de quarante princes et princesses y seront ainsi inhumés entre les 14è et 16è siècles La visite audio-guidée vous plonge par ailleurs dans cette histoire savoyarde et la vie spirituelle de l'abbaye. Et de nous apprendre au passage que Hautecombe fut aussi source d'inspiration pour le poète romantique Lamartine. A mon arrivée, je suis accueilli par Valentin, Tchadien de naissance avec qui j'échangerai sur mes périples africains, et Soeur Marguerite, qui m'autorisera à effectuer mes prises photo et vidéo. Actuellement en cours de rénovation, seule l'église est ouverte aux visiteurs. Alors que j'arpente les travées de l'édifice, je me souviens que l'abbaye fut fondée au 12è siècle par des moines cisterciens de l'ordre de Cîteaux, et devint au Moyen-Âge la nécropole des comtes de Savoie. Alors que l'endroit tombait en désuétude après la Révolution, le roi de Sardaigne Charles-Félix racheta l'ensemble en 1824 et le restaura sur ses fonds propres, avant de rappeler les moines cisterciens à occuper de nouveau les lieux. En visite libre, Valentin vous remet un document contenant une information exhaustive sur l'église et ses merveilles pour la (très) modeste somme d'un euro.
Autre belvédère, celui d'Ontex, qui permet d'admirer une vue imprenable sur l'Abbaye de Hautecombe (en photo ci-dessous). Là encore, la vue est imprenable sur le lac du Bourget. Et là aussi se trouve un restaurant où il est possible de passer un délicieux moment en profitant du paysage (voir infos pratiques). Réhabilité en 2010, ce belvédère se mérite car on y accède par une petite route tortueuse, jusqu'à atteindre 608 mètres de haut, le point culminant de l'endroit. De ce côté du lac, le belvédère de la Chambotte révèle ses secrets, la ligne ferroviaire Culoz- Aix les Bains paraît minuscule, tout comme Brison-les-Oliviers. Les plus audacieux (et il y en a!) choisiront de faire le tour du lac à vélo, depuis ce belvédère, soit une distance de 57 kilomètres, tandis que d'autres préfèreront effectuer l'une des trois boucles de randonnées locales, à savoir le sentier de la Cauche (en 2h10, 378 mètres de dénivelé), le sentier du Communal (2h50, 414 mètres de dénivelé) ou le sentier du Mont (1h10, 190 mètres de dénivelé).
Proche d'Ontex, se dresse la Dent du Chat (ci-dessous), l'un des sommets du mont du Chat, qui culmine à 1390 mètres. Ainsi le mont du Chat est-il évoqué pour la première fois dans une charte de 1232 faite à Chambéry. La Dent (du Chat), elle, est un pic en forme de canine (pas forcément celle du félin suggéré!) et doit son nom au sens ancien du terme « chat » qui signifiait alors « passage », un peu comme le « chas d'une aiguille ». D'autre part, l'histoire de ce pic est liée à la légende de ce pêcheur qui tentait vainement de prendre une prise sur le lac. Désespéré, il promit à la Providence qu'il libérerait le poisson capturé, promesse qu'il ne tint pas. Si bien que sa deuxième prise fut un...chaton qu'il adopta immédiatement. L'animal étant devenu un beau gros chat quitta un jour la maison du pêcheur et alla se réfugier au sommet du piton rocheux, d'où il entreprit de terroriser les rares visiteurs franchissant le col. Au final, seuls les compagnons du roi Arthur, Bérius et Mélianus, parvinrent à venir à bout de l'animal en le tuant avec des flèches. En récompense, le roi offrit un champ à Bérius (champ Bérius, devenu Chambéry) et un mont à Mélianus (mont Mélianus devenu Montmélian). La canine du félin, elle, est restée au sommet, d'où la Dent du Chat !
J'achève cette balade par Le Bourget du Lac, commune immortalisée dans la seconde moitié du 19è siècle par le peintre Jacques Morion. L'endroit ne me laissera pas au premier regard un souvenir impérissable, excepté son vieux prieuré transformé en locaux communaux et pas suffisamment mis en valeur (j'arriverai malgré tout à chiper la photo ci-dessous à travers la fenêtre d'une porte!) ainsi que l'église Saint-Laurent, avec ses hauts reliefs polychromes représentant des scènes de la vie du Christ (deuxième photo). L'histoire est pourtant passée par là, puisque le Prieuré clunien Saint-Maurice qui y est bâti vers la fin du 11è siècle dépendait directement de l'Abbé de Cluny. En 1582, ce prieuré sera donné aux jésuites de Chambéry, puis aux Cordeliers en 1773. Transformé en ferme à la Révolution, l'édifice sera racheté par la Duchesse de Choiseul qui y fera aménager des jardins de style néoclassique. Entre 1055 et 1058, des moines de Cluny seraient venus s'établir au Bourget sur un domaine offert par le comte de Savoie. D'où le Prieuré et l'église qui prospéreront jusqu'au 13è siècle. Pourquoi Saint Maurice ? Parce qu'il est le patron de la maison de Savoie. Quant à la Prieuriale, elle deviendra l'actuelle église paroissiale Saint-Laurent.
INFOS PRATIQUES :
|