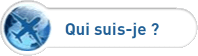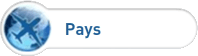Revoir le globe

|
Rocha
(Département de Rocha, Uruguay) |
|
Dimanche 28 mai 2017
Le temps est couvert ce matin à Maldonado lorsque je me réveille. Il se couvrira encore plus vers l'est alors que je me rendrai plus tard dans le département de Rocha, au point de voir la pluie tombée dès la fin de ma séance de photos. Quand la providence veille... Mon GPS fonctionne dans cette partie du pays mais pousse parfois le délire à me proposer un itinéraire plus compliqué. Ainsi ce matin, me fera t-il passer par la ruta 10, une route côtière bordée de villages avec leurs ralentisseurs tous les 200 mètres. Puis une piste criblée de trous m'attendra pour la deuxième partie de mon parcours. Je croiserai d'ailleurs un véhicule ayant fait des tonneaux, et assisté par la police et les secours lors de mon passage. J'apercevrai un automobiliste qui me conseillera un parcours plus adéquate afin d'atteindre Rocha, puis La Paloma (où se trouve mon hôtel) dans de meilleures conditions.
Rocha, où je vous emmène cette fois, est la capitale du département de Rocha. La ville fut fondée le 23 novembre 1793 sous l'impulsion de Rafael Perez del Puerto, lequel atteindra l'Uruguay en 1777 depuis l'Espagne. D'abord appelée Nuestra Senora de los Remedios de Rocha, l'endroit devra son nom à un certain Luis Rocha qui s'installera à l'époque dans ce coin désertique avec l'intention d'y faire le commerce du cuir. Le mot « Rocha » vient de roza, qui signifie en langue portugaise le champ prêt à être ensemencé. S'il y a bien une cité qui est construite en damier, c'est bien Rocha (ci-dessus). Je m'y promènerai durant près de deux heures afin d'y parcourir l'un des cinq circuits proposés aux visiteurs par l'office de tourisme local. Oh, je n'y verrai rien de transcendantal mais un certain charme se dégage tout de même de cette cité incroyablement déserte en ce dimanche après-midi. Ma visite débute depuis la Place de l'Indépendance (deuxième photo ci-dessus), au bord de laquelle s'élève l'église nommée plus haut qui est supposée avoir été la première construction érigée ici à la fin des années 1700. Les première familles qui s'établiront à Rocha viendront de Galice et de la Principauté des Asturies (Espagne). A l'origine, celles-ci partaient à la conquête de la Patagonie mais le bateau à vapeur les débarquera finalement sur la côte de Maldonado, où elles seront prises en charge, puis invitées à s'installer à Rocha. L'église citée plus haut n'était alors qu'une petite chapelle lorsqu'elle fut bâtie en 1794. Le terrain sur lequel la ville actuelle fut érigée appartenait quant à lui à José Texeyra Caballero.
Livré à moi-même, je ne rencontrerai aucun panneau descriptif des monuments rencontrés lors de ce circuit N°1. J'observerai donc l'architecture des maisons, des constructions souvent basses bordant des rues pavées et parfois étroites, pleines de souvenirs des siècles passés. Les apports successifs de populations immigrées contribueront à enrichir la ville de nouveaux talents mais la cité ne disposera d'une certaine autonomie administrative qu'avec la création du département de Rocha au début du XIX ème. Mon parcours prévoit la découverte de plusieurs résidences comme celle de la famille Demichelli (ci-dessus) dans la rue 25 de Agosto, avec, en-dessous de l'appartement, la boutique. Cette dernière appartient désormais au passé. J'apprécierai beaucoup les façades colorées comme celle du centre social ouvrier, toute orange, ou encore cette façade bleue et blanche (deuxième photo ci-dessus) rencontrée dans la rue J.P.Ramirez. A titre d'exemple, en 1900, Rocha comptait 28 maisons particulières en construction dans sa rue principale, des demeures qui mobilisaient alors quasiment une centaine de personnes dans différents corps de métier. L'Etat uruguayen, lui, n'avait encore rien investi dans cette ville, si ce n'est les quelques travaux réalisés au profit de l'hôpital de charité en 1888, et elle se contentait de louer les locaux qui lui étaient parfois nécessaires. Il faudra attendre l'arrivée de Juan Lindolfo Cuestas au pouvoir pour que Rocha reçoive une première somme de 50000 pesos pour bâtir plusieurs bâtiments publics dans le département. C'est ainsi que la prison départementale (ci-dessous), le Palais municipal (deuxième photo), un premier commissariat de police, une première école et le théâtre Escuela Ramirez verront peu à peu le jour.
Dès 1901, commenceront les travaux de la prison aujourd'hui à l'abandon, mais il faudra attendre 1915 pour la voir achevée. En 1902, d'autres travaux seront effectués sur l'église. Puis, huit ans plus tard, sera inauguré le Palacio Municipal. Les premières automobiles circuleront en ville dès 1912, et les rues d'être progressivement recouvertes de ces pavés ronds toujours d'actualité. Rocha sera aussi fréquenté par d'illustres personnages (qui ne figurent curieusement pas dans les circuits proposés par l'office de tourisme). Ainsi tomberai-je par hasard sur une plaque indiquant que Felisberto Hernandez aura passé ici une partie de son existence (ci-dessous). Cela vaut bien quelques explications : notre homme, né le 20 octobre 1902 à Montevideo, sera compositeur, pianiste et écrivain uruguayen. Il commencera le piano à seize ans, et publiera ses premiers écrits à 23 ans, d'abord sous la forme de récits de voyage à l'intérieur du pays, ensuite à travers de narrations au style à la fois drôle et fantastique, enfin en tombant dans l'extravagance comme avec, par exemple, son livre « Nadie encendia las lamparas » et « La casa inundada ».
Mon circuit prévoit la visite de plusieurs paseos (promenades) dont celui du Candombe, qui va de la Place de l'Indépendance à la Place Pedro Lapeyre. Le principal intérêt de cette balade réside dans les peintures murales (ci-dessous) qui ornent certaines façades de maisons, et représentent des scènes de la vie locale. Celui met un peu de couleur dans cette grisaille hivernale. La place Pedro Lapeyre (jadis appelée Place des lavandières) ne me fera pas très bonne impression mais elle est pourtant la plus ancienne du genre à Rocha, puisqu'elle apparaît sur le premier plan de la ville tracé par Pedro Douguet, arpenteur, qui oeuvrera ici vers 1870. Cette place présente pourtant un intérêt culturel d'importance car y convergent à la fois des personnages, des légendes, le carnaval, la musique et la fête. Force est de constater que la joie ne domine pas aujourd'hui. D'ailleurs, je me méfierai des places de Rocha. Entre la Place de l'Indépendance où j'apercevrai une banderole de soutien à la révolution vénézuélienne de Nicolas Maduros et celle du Congreso de 1813, où je devrai retirer un pneu de vélo qui servait de collier à la statue de la mère et l'enfant (deuxième photo) avant de prendre un cliché de la pauvre femme, je me dis qu'on se préoccupe décidément peu de la mise en valeur du patrimoine dans cette ville.
Revenons quelques instants sur l'histoire du département. Ici comme ailleurs en Uruguay, d'autres peuples vécurent ici jusqu'à l'arrivée des Espagnols puis des Portugais. Les cerritos de indios (monticules constituant des vestiges archéologiques) en témoignent encore. Peu à peu, les nouveaux venus élevèrent du bétail dans ces plaines pour en tirer du cuir. Luis de Rocha faisait partie de ces éleveurs. Puis apparut aux abords de la rivière Cebollati, une sorte de république de gauchos alimentée par les immigrés venus des Iles Canaries (Espagne) en 1724, pour fonder Montevideo. Le département de Rocha sera fondé après son voisin de Maldonado, en 1880. Et de s'étendre sur 180 kilomètres le long de l'océan, offrant ses plages interminables aux énormes rouleaux d'eau salée, son sable blanc, ses zones rocheuses (qui connurent ici bien des naufrages) et ses rivages escarpées. A la différence d'autres départements uruguayens (Canelones, Colonia, San José ou Montevideo), ce département-là n'appartient pas au Rio de La Plata. Cette région vit essentiellement de l'élevage, mais également de la pêche (pratiquée dans tout le département). On trouve par ailleurs du cuivre, du marbre et du lignite dans la zone surnommée Cuchilla de Carapée. L'agriculture, elle, produit du tabac, des céréales, des tomates, du maïs, des fruits et des légumes. On y fait enfin le commerce des cuirs, de la laine et de l'alcool. Par ailleurs, le tourisme occupe une place importante dans le développement économique de ce département qui possède plusieurs stations balnéaires (dont La Paloma, où je me trouve actuellement). A mi-distance entre le Brésil et la capitale uruguayenne, le département sert en quelque sorte de trait d'union et voit passer Argentins, Brésiliens et Uruguayens.
INFOS PRATIQUES :
|