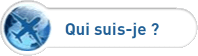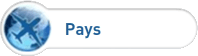Revoir le globe

|
De la Baie Saint-Paul à la Malbaie
(Québec, Canada) |
|
Samedi 5 mai 2018
On s'accorde à dire ici que le printemps est tardif cette année et davantage pluvieux. Il n'empêche que la météo reste imprévisible puisqu'on nous annonçait de la pluie pour aujourd'hui samedi et que je me réveille ce matin avec un joli soleil sur fond de ciel bleu, après les pluies diluviennes de la nuit dernière. Je quitte Denise, mon hôte depuis deux jours, et son hébergement douillet pour me diriger vers La Malbaie, ma prochaine étape, tout en photographiant au passage la ville de Baie Saint-Paul (ci-dessous). J'ai prévu de m'arrêter à différents endroits afin de découvrir différents aspects culturels de la jolie province québécoise. Après un solide petit-déjeuner, je prends la route de Saint-Placide de Charlevoix pour y découvrir un pont couvert (deuxième photo ci-dessous) unique en son genre dans tout le Québec, même si le premier pont similaire avait déjà été bâti en 1806, en Amérique, du côté de Philadelphie. A une certaine époque, on en comptait neuf dans la région de Charlevoix (et jusqu'à 245 ponts similaires en 1965 au Québec). Celui-ci fut construit en 1926 par le contracteur Jos Normandeau pour la somme de 2076,21$ afin d'enjamber la rivière du bras Nord-Ouest. De type Town québécois, et de conception suisse, l'ouvrage est une version modifiée de la structure jadis brevetée par Ithiel Town dans le Connecticut (Etats-Unis) et mesure 34,47 mètres de long et 5,70 mètres de large. Son portique est de type classique et la hauteur de son ouverture est d'un peu moins de 4 mètres. Notons toutefois que l'arche et le toit sont d'inspiration européenne. L'ensemble a été cité monument historique en octobre 2002.
Je rebrousse ensuite chemin en direction de Saint-Joseph de la Rive, qui appartient en réalité à la commune des Eboulements, depuis la fusion de plusieurs villages. Là se trouve le Musée maritime de Charlevoix, ancré entre fleuve et montagne.L'endroit ne sera ouvert au public que dans quelques jours mais on m'autorise malgré tout à faire le tour du propriétaire : aménagé en 1946, ce chantier maritime est l'un des rares survivants de son époque à avoir conservé des équipements témoignant des activités de réparation et d'hivernage reliées au cabotage artisanal sur le fleuve Saint-Laurent.Il fut érigé sur le site principal de construction de goélettes depuis le début de la colonie jusqu'à la fin des années 1960. D'abord à voile, puis à vapeur, ces embarcations joueront un rôle considérable dans l'économie locale liée au fleuve. Parmi les activités, on trouvait l'hivernage des bateaux en bois qui ne pouvaient pas naviguer sur le Saint-Laurent durant l'hiver en raison des glaces et du froid. Les navires étaient ainsi mis à l'abri, à marée haute, dès la mi-novembre, puis réparés entre temps. Le chantier de Saint-Joseph de la Rive pouvait alors accueillir jusqu'à 28 goélettes en hivernage. Le premier bateau, le Cap aux Rets, construit à Baie Saint-Paul en 1927, hiverna ici en 1946. Une salle d'exposition propose également au public de découvrir les nœuds marins (photo ci-dessous) indissociables de cet art de la corderie qui permit aux hommes de voguer à travers le monde. Il faut savoir qu'à l'époque de la grande voile, un trois-mâts de mille tonneaux pouvait embarquer plus de 50 tonnes de cordages de touts sortes. Et des centaines de nœuds différents, d'épissures, surliures, amarrages et garnitures de participer à la manœuvre.
Le musée offre bien sûr la possibilité de visiter plusieurs bateaux comme, par exemple, la Marie-Clarisse (ci-dessous) : presque centenaire, cette embarcation est l'une des plus anciennes goélettes de bois encore en état de naviguer. Joyau maritime, celle-ci sera restaurée à plusieurs reprises. Construite en 1923 par James H.Harding à Shelburne (Nouvelle-Ecosse), la goélette portera d'abord le nom de Archie F.Mackenzie et sera utilisée pour la pêche, puis pour le transport de marchandises entre la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve. Le navire sombrera dans le port de Québec en février 1976 puis sera renflouée sept mois plus tard, remorquée jusqu'à l'Isle aux Coudres où elle sera remise en état. On la rebaptise alors Marie-Clarisse un an plus tard, puis on en fait un navire-école pour des stagiaires en matelotage, en voilerie, en cartographie sous-marine et en météorologie. Et d'être désignée objet patrimonial par le gouvernement québécois en 1978.
Tout près du musée se dresse la boutique des Santons de Charlevoix (ci-dessous). Ramené lors d'un voyage en Provence (France), un santon transforma l'existence de Bernard Boivin qui créa l'affaire il y a 32 ans. Fasciné par ce petit personnage coloré, notre homme se mit à fabriquer des santons locaux, ceux de Charlevoix, à l'image de la culture québécoise. Si, tout comme en Provence, la crèche québécoise et ses personnages s'imposent naturellement, d'autres figurines firent également leur apparition comme le gigueur, le violoneux, le bonhomme sept-heures, le Père La Brosse, l'amérindien au tambour ou la tricoteuse...
Une autre merveilleuse histoire m'attend de l'autre côté de la rue : la papeterie Saint-Gilles, installée dans une ancienne école communale, fut fondée en 1965 par Monseigneur Félix-Antoine Savard, l'auteur du célèbre roman Menaud, maître-draveur. Complètement transformée en 1988, elle devient bientôt le premier économusée du Québec et un musée du papier unique en son genre puisque l'entreprise fabrique artisanalement des papiers de toutes sortes, au milieu de collections anciennes et actuelles. Depuis quarante ans, les artisans enchainent inlassablement les différentes étapes de fabrication (défibrage, encuvage, tamisage, pressage, séchage et calandrage) d'un papier 100% coton et sans acide, comme cela se faisait déjà au 17è siècle. Certaines feuilles contiennent même des pétales de fleurs locales. La papeterie dispose enfin de sa propre Fondation qui décerne chaque automne quatre prix d'excellence dans les domaines de la poésie, des arts et traditions, du design et de la création et des métiers d'art. Une boutique propose une large gamme d'articles en vente sur place ainsi qu'une boutique en ligne pour effectuer vos achats à distance.
Je reprends la route en direction des Eboulements. C'est en 1683 que les frères Charles et Pierre de Lessard se feront concéder le territoire de la Seigneurie des Eboulements. Pierre Tremblay, qui fera l'acquisition de celle-ci en 1710 et la développera en accordant à son tour d'autres concessions, est considéré comme le bienfaiteur de cette commune qui accueillera plus tard un premier manoir seigneurial, près du fleuve, édifice malheureusement disparu depuis. Dès 1724, on fabriquera sur place du goudron à partir du bois de pin, puis, le seigneur bâtira lui-même le moulin seigneurial (moulin banal) avec ses fils, en 1790. Vers 1810, la Seigneurie sera cédée à Pierre de Sales Laterrière, une famille d'ailleurs associée de longue date à l'histoire de ce village connu comme l'un des plus anciens du comté de Charlevoix. L'endroit portera d'abord le nom de l'Assomption de la Sainte Vierge (à partir de 1855) et comptera plus de 200 habitations le long de la côte, face au fleuve. Quatre ans plus tard, le pouvoir municipal sera instauré et entrainera au passage l'abolition du régime seigneurial. Et le village de se développer alors autour de la construction maritime, de l'agriculture et de la forêt. La commune des Eboulements, qui a toujours fonctionné en interaction avec Saint-Joseph de la Rive et fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec (photo ci-dessous) prendra son nom actuel à la suite d'un fort séisme qui survint dans la région de Charlevoix en février 1663. Ce tremblement de terre occasionna le déplacement d'un important morceau de terre à l'emplacement de l'actuel village de Saint-Joseph de la Rive, longtemps surnommé Les Eboulements en-bas. Le village Les Eboulements tient son nom officiel depuis 1859.
Sur la route du fleuve, je fais une halte dans une ferme d'alpagas (ci-dessous), les cousins des lamas. Ce mammifère domestique plutôt sympathique et très curieux est ici exploité pour sa laine, laquelle sert à confectionner des articles chics et chauds. Sa durée de vie est de trente années et son poil peut être de deux types (poil mi-long et frisé voire ondulé pour le huacayo, poil long et tombant comme des mèches pour les suri). Tondu généralement une fois par an, au mois de mai ou juin, l'alpaga livre d'abord le poil de ses pattes. Ensuite, la tonte a lieu selon les différentes qualités de sa laine, en sachant que la première qualité se situe sur le dos, puis le cou, et toutes les autres parties du corps. Selon la taille de l'alpaga, on peut ainsi collecter jusqu'à 2,5 kg de laine en moyenne.
Sur la même route, mais à quelques kilomètres de là, je rends visite à Jean-François Lettre, artisan-ébéniste qui réalise d'étonnantes compositions à base de bois : notre homme utilise un bois qui a chauffé ou en voie de pourrissement car ce matériel offre des motifs et des teintes inégalés. Ses essences favorites sont le bouleau blanc, le sorbier, le frêle et l'érable.Le reste se passe entre l'artiste et la matière et chaque œuvre est, selon les dires de Jean-François, »le fruit d'un dialogue entre moi et l'arbre ». Et de se laisser imprégner par les nœuds, les courbes et les imperfections qui ont marqué l'histoire du bois travaillé. Ci-dessous, une oeuvre intitulée « le souffle du dragon » et une sculpture nommée « le fragtale ». Des œuvres qui se monnayent entre 300 et ...2000$, mais, c'est bien connu, le talent n'a pas de prix !
INFOS PRATIQUES :
|