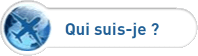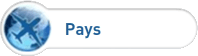Revoir le globe

|
La Malbaie
(Québec, Canada) |
|
Dimanche 6 mai 2018
Petite ville située dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, La Malbaie porte un nom pour le moins significatif. C'est en effet Samuel de Champlain qui l'appela ainsi lorsqu'il apercevra cette baie vaseuse (ci-dessous) à marée basse et très peu profonde , à laquelle il donnera le nom de Malle Baye. Autrefois, l'endroit était une seigneurie qui s'étendait des Eboulements à Saint-Siméon. Puis, on fonda en 1845 la municipalité de Saint-Etienne de la Malbaie, avant que le village de la Malbaie ne s'en détache en 1896 et obtienne son statut de ville en 1958. Depuis lors, ce lieu de villégiature est très fréquenté par la grande bourgeoisie canadienne et américaine, un endroit fort agréable situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent et à l'embouchure de la rivière Malbaie qui prend sa source dans les Laurentides, à 161 kilomètres d'ici.
Lieu à la fois incontournable et d'actualité (puisque le prochain sommet du G7 s'y tiendra dans un mois), le Manoir Richelieu reste le témoin de l'époque des nombreux bateaux à voile qui sillonnaient le fleuve. Ce château surplombe le Saint-Laurent (ci-dessous) et offre à ses hôtes une vue époustouflante sur les environs. La région de Charlevoix est reconnue pour sa grande hospitalité et son charme champêtre et a longtemps attiré peintres, poètes et musiciens de tout le Québec. Déjà, en 1761, des vacanciers venaient ici pour pêcher le saumon et apprécier les somptueux paysages. A l'époque, la région ne possède pas d'hôtel de prestige pour recevoir les invités de marque débarquant des bateaux de croisière de la Richelieu & Ontario Navigation Company et de la Canada Steamship Lines. Rodolphe Forget, homme d'affaires et homme politique canadien, propose alors au conseil d'administration Richelieu Ontario de bâtir un grand hôtel à Pointe-au-Pic, qui dispose déjà d'un quai pour les bateaux à vapeur, depuis 1853. Et la construction du Manoir Richelieu (devenu depuis Fairmont Le Manoir Richelieu et en photo ci-dessous) de débuter en 1898 pour s'achever un an plus tard. Le bâtiment offre à l'époque 250 chambres. L'établissement brûlera entièrement à l'automne 1928 alors que les employés préparaient sa fermeture pour l'hiver. Il ne fallut qu'un mois pour que le chantier de reconstruction du site ne soit confié à l'architecte canadien John Archibald. Et le nouvel hôtel de style château français d'être inauguré en juin 1929, avec ses 350 chambres. En 1971, l'endroit passera aux mains de l'américain John Dempsey avant d'être repris quatre ans plus tard par le gouvernement du Québec. En décembre 1985, l'hôtel sera évalué à cinq millions de dollars. Le gouvernement québécois acceptera alors de céder l'ensemble à Raymond Malenfant pour 555555,55 dollars à condition que ce dernier s'engage à investir 12 millions en immobilisations les deux années suivantes.
Depuis, le prestigieux établissement propose aux amateurs de golf un parcours de 27 trous jouissant d'une réputation internationale. Ce parcours, conçu par l'architecte britannique Herbert Strong, fut inauguré en 1925 par le Président américain William H.Taft. 1998 vit s'effectuer d'importants travaux de rénovation (pour plus de 140 millions de dollars) et d'agrandissement pour permettre à l'établissement de retrouver son statut de luxe de classe internationale, avec ses 405 chambres et son célèbre casino de Charlevoix. Ce dernier, ouvert en 1994, a pris place dans l'ancien théâtre d'été du Manoir Richelieu et donnera un nouvel essor à l'établissement hôtelier. Faisant preuve d'une grande courtoisie, le personnel du Manoir m'a autorisé à photographier exceptionnellement la peinture qui orne l'une des salles de banquet, œuvre représentant Christophe Colomb à la cour du roi Ferdinand et d'Isabelle 1ère de Castille (ci-dessous).
Sur le chemin du retour, je m'arrêterai au quai Casgrain, un ancien quai fédéral remis à la municipalité de La Malbaie par le gouvernement du Canada. Le site, anciennement chantier de construction de goélettes, est devenu depuis un petit parc d'attraction pour petits et grands et un lieu d'escale pour le garrot d'Islande, un oiseau venu d'Europe. On en compte seulement 4500 qui vivent dans l'Est de l'Amérique du Nord, dont plus de la moitié hiverne près des rives de l'estuaire du Saint-Laurent, surtout du côté de Charlevoix. La Malbaie en accueille un grand nombre l'hiver.
Curieux d'en savoir plus sur les arts populaires de la région, je file au Musée de Charlevoix : ce musée acquiert,conserve, étudie et met en valeur les patrimoines historiques, artistiques et culturels de cette région en se concentrant surtout sur l'art populaire. A l'origine, un couple de villégiateurs et peintres américains, Maud Cabot et Patrick Morgan organisèrent des expositions d'art dans les années 1930, tout en s'intéressant aux artistes locaux. En 1946, Roland Gagné, collectionneur de Pointe-au-Pic mit en place un musée en l'honneur de l'écrivain Laure Conan, originaire de La Malbaie, l’ancêtre du musée actuel, qui prit forme en 1975, au centre-ville, dans un ancien bureau de poste, avec pour base les collections de Roland Gagné. Et d'offrir désormais au public l'exposition « Charlevoix raconté » qui rassemble l'une des plus imposantes collections d'art populaire du pays. J'y découvrirai la terre originelle à travers explorateurs, vacanciers ou artistes de passage et la vie quotidienne et ses rudesses des habitants de la région et des artistes populaires. Cette exposition s'ouvre sur cette météorite qui frappa le Québec il y a 350 millions d'années. D'un diamètre de 2 km, celle-ci tomba ici-même, sur l'actuelle commune des Eboulements et modifia la topographie de Charlevoix. La météorite de 15 milliards de tonnes créera des ravages inouïs en enfonçant l'écorce terrestre et en créant un vaste cratère. Plus tard, les deux vallées du littoral et les plateaux de faible altitude en bordure de l'astroblème (blessure laissée dans l'écorce terrestre fracturée) se révèleront être propices à l'installation des premiers habitants puisque 90% de la population de Charlevoix y habite, même si c'est d'abord du côté du fleuve que se tournent les première peuplades.
Samuel de Champlain, navigateur aguerri, fixera les rochers de la baie, le cap où nichent les oiseaux, l'anse de sable hostile à la navigation comme autant de repères géographiques. Et de donner aux choses des noms imagés, comme la rivière du Gouffre et Malle-Baye, laissant deviner les dangers à s'aventurer dans certains endroits (une rivière trop accidentée ou une baie s'asséchant à marée basse). Quant aux habitants, longtemps isolés de la civilisation par l'hiver, ils développeront peu à peu un sens aigu de la débrouillardise et un mode de vie proche de l'autarcie. Paradoxalement, c'est cette difficulté à accéder à la région qui permettra de conserver intacts paysages pittoresques et milieux naturels. Indispensables pour l'approvisionnement en eau et en poisson, rivières et sources d'eau douce balisent le territoire et déterminent l'emplacement des villages, interdisant toutefois tout développement industriel par leur manque de débit et de profondeur. L'estuaire du Saint-Laurent dispose alors de ressources si considérables pour assurer la survie des habitants de Charlevoix qu'on désignera certaines localités côtières par le poisson séché qu'on y trouve. Les techniques de pêche mises au point par les autochtones, ou apportées par les Basques, vont se développer et donner lieu à plusieurs spécialités locales : anguilles de petite-Rivière, capelans de Saint-Irénée ou marsouins de l'Isle aux Coudres...de son côté la goélette est utilisée pour la pêche, le transport de billes de bois, de marchandises ou pour relier les villages de Charlevoix avec les régions voisines en l'absence de réseau routier avant les années 1970. Au 19è siècle, les voiliers transatlantiques font aussi partie du paysage local et révèlent un commerce lucratif avec la Grande-Bretagne. A La Malbaie, des petits bateaux transportent les cargaisons de bois de ces navires jusqu'au rivage. Pour franchir sans danger les traverses dangereuses et s'échouer à marée basse sur les rives, près des villages côtiers, les goélettes disposent de coques à fond plat capables de s'échouer facilement. La goélette de Charlevoix est alors célèbre pour le transport de la « pitoune » et la navigation de cabotage.
Au 19è siècle, l'importante croissance démographique de Charlevoix va entrainer le développement intense des terres fertiles. Les plateaux situés entre le littoral et l'arrière-pays sont de plus en plus peuplés et ces riches terres commencent à se faire rares. Le climat instable, le sol rocheux et le relief accidenté ne facilitent pas la vie des agriculteurs face à des hivers rigoureux. Originaires de Baie Saint-Paul, les sœurs Bolduc (ci-dessus) artistes autodidactes, livrent une vision réaliste de cette vie d'antan, en créant des techniques originales pour retranscrire des scènes animées et vivantes surgies de souvenirs d'enfance et les chroniques de vie traditionnelles de leur village. L'automne reste quant à lui la saison de la chasse et le moment de se constituer des provisions pour affronter l'hiver. Les villages importants ont à la fois leur magasin général et leur boucherie. L'hiver à Charlevoix s'installe plus tôt et est plus dur qu'ailleurs, surtout en montagne. Les artisanes perfectionnent l'art de tisser l'étoffe du pays, une laine qu'on fait bouillir et fouler pour la rendre imperméable. Cette fibre rigide et feutrée retiendra la chaleur du corps et servira à confectionner vestes et manteaux. Chez les Bouchard, près de Baie Saint-Paul, on abrite plusieurs peintres et sculpteurs. Les sœurs conçoivent une peinture poétique, tandis que le père sculpte et transmet son savoir-faire à ses fils. Il faut reconnaître que la vie à la campagne peut inspirer bien des compositions aux artistes, avec ses paysages bucoliques et champêtres qui ne demandent qu'à devenir des tableaux narratifs évoquant les métiers traditionnels, les soins donnés aux animaux ou la vie d'autrefois en famille. Pendant ce temps, d'autres s'affairent pour cultiver des céréales, principale production agricole. Et le Moulin César d'utiliser au maximum la force du courant de la rivière Gouffre pour transformer le grain en farine. La gourgane, elle, est une fève des marais et sert à la préparation d'une soupe traditionnelle pour ces familles nombreuses (la famille Bouchard compta seize enfants) et la tourtière est un autre plat typique de la région de Charlevoix.
L'artisanat de Pointe-au-Pic suscitera l'admiration des villégiateurs venus en vacances dans la région et un marché verra le jour pour ces artisanes à l'oeuvre, fabriquant tapis crochetés (ci-dessus) et couvertures boutonnées. En 1942, l'artiste Georges-Edouard Tremblay fonde un atelier-école spécialisé dans la technique du tapis crocheté à Pointe-au-Pic. Et ces tapis ou autres objets artisanaux de permettre d'arrondir les fins de mois pour bien des familles modestes. A la ferme, on trouve Robert Cauchon, artiste et fils de cultivateur, qui connait bien les traditions de gens du peuple, au travail dans les champs ou à la grange, mais également leurs fêtes. Son style d'oeuvre se démarque par un dessin fait de lignes élégantes, en arabesques. La basse-cour fait partie de cet univers avec ses œufs frais et ses volailles. On trouve aussi les légumes du potager entreposés au frais dans des caveaux, ou les fruits des champs qu'on transforme en confiture pour mieux les conserver. Le mouton, d'abord élevé pour sa laine, sera longtemps absent des assiettes des Charlevoisiens, même si désormais, l'appellation contrôlée « agneau de Charlevoix » profite d'une reconnaissance internationale. Quant au lait des brebis, il donne de délicieux fromages.
La vie à la campagne nécessite des dons manuels qui amènent certains habitants à exercer des métiers traditionnels (menuisier, forgeron ou maréchal-ferrant), à la fois indispensables au bon fonctionnement de la ferme et véritable potentiel artistique. Dès le 18è siècle, la plupart des familles de Charlevoix possèdent un métier à tisser pour fabriquer les vêtements et les objets nécessaires à la maisonnée. Lin, laine et coton sont alors utilisés pour confectionner les précieux tissus, tandis que la technique du boutonné sera utilisée pour la fabrication des couvertures. On ne perd rien non plus, puisque la guenille (vieux vêtements taillés en lanières) est tissée en catalogne. On l'utilise pour confectionner des tapis crochetés utilitaires, puis décoratifs, pour orner les murs des maisons.
Les villages situés en montagne comme Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain ou Saint-Aimé-des-Lacs sont difficilement accessibles et la vie sur place représente un défi quotidien. Les terres agricoles sont rares et les paroisses s'y installeront que tardivement. A travers ses tableaux, Philippe-Edouard Maltais (ci-dessus, avec le Pont de la rivière Malbaie) témoigne d'un mode de vie appartenant à cet environnement extrême et au relief démesuré. Et se souvient de la cueillette des petits fruits, de la pose des collets pour capturer les lièvres ou de la pêche au saumon... Le premier train reliant Québec à Baie Saint-Paul n'apparaitra qu'au 20è siècle, et en 1919 à La Malbaie. Cette innovation technologique sera rendue possible grâce aux efforts de l'homme d'affaires et député Rodolphe Forget. Nous l'avons vu plus haut, la Grande-Bretagne se tournera vers ses colonies pour s'approvisionner en bois et ce, dès 1810. On exploitera alors les sapins et les épinettes des hauts plateaux de Charlevoix et l'industrie forestière de connaître bientôt un essor important. De nouvelles paroisses apparaitront ainsi en 1855 et la population s'établira plus à l'est, au fur et à mesure du développement de nouveaux emplois. Après le fleuve, la forêt contribuera à la croissance de la région, tout particulièrement l'hiver. Navigateurs ou agriculteurs le reste de l'année, bien des hommes deviendront ainsi bûcherons pour quelques mois. Et lorsque le printemps pointe enfin le bout de son nez, les cours d'eau dégèlent et les rondins de bois s'accumulent. On constitue alors une pitoune assemblée en radeaux qui flotte sur les rivières de l'arrière-pays. Des draveurs armés de pics et de bottes à crampons bravent alors ces cours d'eau en faisant flotter le bois en aval vers les moulins à scie, les goélettes ou l'usine de pâtes et papiers de Clermont. En 1912, Rodolphe Forget contribuera à la création de la East Pulp and Paper Canada Company dans ce qui s'appelle aujourd'hui Clermont. Et cette ville de devenir le cœur industrie de Charlevoix, grâce à cette entreprise appelée familièrement ici « la Donohue »,qui fournira le papier nécessaire à l'impression de nombreux quotidiens dont le New York Times. Avec le temps, Charlevoix deviendra Réserve mondiale de la biosphère en décembre 1988, une zone articulée autour de ses parcs, massifs et forêts, soit un immense territoire de 5600 km2. Le parc national des Grands-Jardins, lui, se distingue par la présence d'un troupeau d'une centaine de caribous, un retour en grâce d'un animal disparu vers 1925 et réintroduit depuis 1969. Tout un symbole !
INFOS PRATIQUES :
|