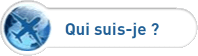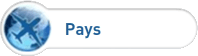Revoir le globe

|
Chicoutimi
(Québec, Canada) |
|
Mercredi 9 mai 2018
Chicoutimi, où je réside actuellement, est l'un des trois arrondissements de la ville de Saguenay et compte plus de 68000 Chicoutimiens, qui peuvent se divertir avec les nombreuses activités culturelles rassemblées sous le croissant culture de la ville. En langue montagnaise, eshko-timiou signifie jusqu'où c'est profond, Chicoutimi voulant dire la tête de la navigation en eau profonde sur la rivière Saguenay, dont la taille varie beaucoup à l'approche de la ville et qui reste navigable jusqu'au pont Sainte-Anne (en photo ci-dessous). Ce n'est qu'en 1931 que la construction de cet ouvrage est entreprise, un pont d'acier reposant sur neuf piliers de béton et comprenant une travée centrale pivotante de 112 mètres qui permet le passage des bateaux. Après 1968, celui-ci ne répondra plus au développement du trafic routier et le pont Dubuc sera alors érigé puis inauguré en 1972, ne laissant passer sur le pont Saint-Anne que cyclistes et piétons.
Une promenade le long du cours d'eau me permet d'observer des eaux noires avec, ici et là, d'importantes traces de mousse blanche. Serait-ce la pollution ? La qualité des eaux fluviales a longtemps laissé à désirer au point qu'il était déconseiller de consommer cette eau polluée par l'industrie papetière locale, l'immense complexe industriel de l'Alcan (aluminium) et par les égouts de la ville qui se jetaient directement dans la rivière. Mon guide Hachette m'avait vanté un vieux port plein de charme avec halles et échoppes mais je découvre sur place un immense parc aménagé aux abords de la rivière et aucun trace de bâtiments anciens. Jadis, l'essor de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi avait pourtant eu d'heureuses circonstances avec le développement d'infrastructures de transports (une gare devait exister ici-même, il n'en reste aujourd'hui ….qu'une charcuterie!), de postes et de télécommunications. Ce développement commercial est surtout visible sur la rue Racine qui arbore encore de nos jours certaines construction de style Art-déco.
L'ancien hôtel des Postes (ci-dessous) date de 1905 et sa construction fut entreprise par le gouvernement fédéral. On doit l'ensemble à l'entrepreneur Adolphe Beaulieu de Chicoutimi, qui érigea ici un édifice de style Second Empire, rare construction à avoir échappé au terrible incendie du 24 juin 1912. Sa vocation était alors de fournir aux Chicoutimiens les services canadiens des postes, de douanes et de télécommunications. Non loin de là, la côte Salaberry formait l'un des plus importants sites de la ville vers la fin du 19è siècle. A cette époque, les habitants vécurent l'inauguration du premier quai en 1882, puis l'arrivée du chemin de fer onze années plus tard, qui allait contribuer de manière considérable au développement commercial dans ce secteur. Toujours sur la rue Racine, et face à l'Hôtel des Postes se dresse la cathédrale (deuxième photo), elle aussi fermée comme toutes les églises du Québec. Quelle tristesse de laisser ainsi à l'abandon ce patrimoine religieux ! Une première cathédrale avait été bâtie sur ce même emplacement en 1878, mais elle sera détruite par le grand incendie de 1912, remplacée trois ans plus tard, et détruite à nouveau par le feu. Cette fois, les architectes Alfred Lamontagne et Oscar Baulé érigeront une cathédrale en pierre, dotée d'un fronton classique, de colonnes et de clochers suffisamment imposants pour dominer la cité. L'intérieur de l'édifice abrite le plus grand orgue Casavant de la région.
Non loin de mon hôtel, dans le quartier du Bassin, s'élève une autre église (elle aussi fermée!), l'église du Sacré-Coeur (ci-dessous) qui fut construite pour répondre aux besoins des résidents locaux. Débutée en 1903, la construction offre ici le plus bel exemple d'architecture gothique de la région et est l'oeuvre de René-Pamphile Lemay. L'intérieur sera aménagé par Alfred Lamontagne en 1929. Notons enfin que toute la pierre de l'édifice (à l'exception de la pierre grise de la façade) fut à l'époque extraite sur place. Quant aux pères Eudistes qui se trouvaient à la tête de cette nouvelle paroisse, ils érigèrent en 1919 un presbytère (deuxième photo) digne de l'église voisine, avec, pour architecte, Alfred Lamontagne. Ce bâtiment imposant, de style château, contrastait alors avec les autres maisons du quartier. Après une restauration effectuée en l'an 2000, cette vaste demeure accueille plusieurs organismes et le populaire Café du Presbytère, où j'ai pris mon petit-déjeuner ce matin. L'ensemble du site est classé monument historique depuis 2001.
Ici comme ailleurs, la nature peut se montrer extrêmement dure, comme en ce mois de juillet 1996, lorsque la rivière Chicoutimi, gonflée par les pluies torrentielles, atteignit en quelques heures seulement, onze fois son débit habituel. Des dizaines de maisons seront alors emportées par les flots et le monde entier pourra voir les images de la désormais célèbre « petite maison blanche » (ci-dessous) résistant à l'une des pires catastrophes naturelles ayant touché le Québec. Ce site dévasté laisse désormais place à un parc urbain. L'histoire de la maison remonte quant à elle aux environs de 1890, lorsqu'elle fut construite avec de grosses poutres en bois. Juste à côté se tenait déjà un barrage de retenue d'eau alimenté par la rivière Chicoutimi, qui permettait l'alimentation d'une centrale hydro-électrique. Une certaine Jeanne d'Arc Lavoie Genest était la propriétaire du lieu au moment du déluge et occupait la petite maison depuis 1938. Celle-ci avait déjà affronté une première inondation en juillet 1947, événement à l'issue duquel la famille avait décidé de doter la maison de solides fondations ancrées dans le roc. La seconde inondation, celle de juillet 1996, occasionnera plus d'un milliard de dollars de dégâts, détruisant au passage digues et barrages. Le musée aménagé dans la maison raconte ces évènements douloureux.
Autre curiosité incontournable de Chicoutimi : l'ancienne Pulperie, devenue aujourd'hui un vaste complexe culturel et touristique. Le site ne se trouve qu'à une dizaine de minutes de marche de la petite maison blanche, aux abords de la rivière Chicoutimi (ci-dessous), et offre plusieurs expositions ainsi que l'ancienne maison du peintre Arthur Villeneuve. C'est le 24 novembre 1896 que le maire de l'époque, Joseph-Dominique Guay, fonde avec quelques amis la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi destinée à produire de la pâte à papier. L'endroit est idéal puisqu'il offre à la fois le bois avec les forêts alentours, et l'eau avec la rivière toute proche sur laquelle sera construit un moulin. Très vite, la pulperie connaitra un tel succès qu'elle deviendra exportatrice de pulpe de bois au niveau international et comprendra bientôt trois moulins. Et Chicoutimi de devenir la capitale mondiale de la pulpe, fournissant celle-ci à l'Angleterre lors de la Première guerre mondiale. En dépit de cette renommée, l'activité de l'entreprise décroitra dans les années 1920 et cessera toute activité en 1930. Vous vous demandez sans doute, comme moi, en quoi consiste le procédé de fabrication de la fameuse pulpe : tout part du bois, matière première abondante dans la région. Ce bois doit être fibreux, ce qui est le cas de l'épinette noire et du sapin particulièrement abondants ici. Il faut ensuite disposer d'un puissant cours d'eau qui acheminera les troncs d'arbres le moment venu. De ce point de vue, la rivière Chicoutimi offre une force hydraulique suffisant qui équivaut à 25000 CV. Les bûcherons profitent alors du long hiver et du gel des cours d'eau pour abattre les arbres en nombre suffisant afin d'alimenter l'usine de pâte à papier pour le reste de l'année. Les billots sont ensuite entreposés sur la rivière glacée. Lors du dégel, ces billots seront pris en charge par des draveurs qui veilleront au bon acheminement du bois vers le monte-billot de la scierie. C'est en effet à la scierie que chaque billot sera découpé en tronçons de 60 centimètres. Tronçons plus tard acheminés vers les sites de production où des écorceurs débarrassent les tronc d'arbres de leur écorce à l'aide de lames tournant à grande vitesse. Les billots écorcés sont ensuite acheminés dans les moulins où des pistons hydrauliques pressent le bois contre des meules en granit qui tournent à grande vitesse. Leur surface striée défibre ainsi le bois et transforme les billots en minuscules particules de bois. Ces particules, mélangées à de grandes quantités d'eau, passent ensuite à travers plusieurs tamis puis sont dirigées en direction des métiers (machines permettant aux particules de bois de s'agglomérer jusqu'à former une feuille d'une épaisseur de 5 millimètres). Cette feuille de pulpe est alors coupée par un ouvrier, pliée en quatre puis recouverte d'un treillis métallique. Les feuilles sont alors rassemblées jusqu'à former des ballots de pulpe gorgés d'eau. Des presses hydrauliques entrent alors en action et retirent la moitié de l'eau contenue dans ces ballots, le reste de l'eau servant à préserver la qualité de la pulpe de bois. La pulpe produite à Chicoutimi partait en train vers des horizons lointains, à destination de New-York, ou à bord de bateaux pour l'Angleterre.
Vous connaissez ma philosophie : le monde et ses œuvres appartiennent à tout le monde et ne sont pas forcément une question d'argent. Devant les restrictions qui me sont imposées (voir infos pratiques), je renonce à visiter ce centre culturel, me contentant de prendre quelques clichés à l'extérieur des bâtiments. D'autres photos ont été récupérées sur internet. La maison-musée d'Arthur Villeneuve, elle, se trouve également dans ce complexe depuis 1994. C'est en 1957 que notre homme, peintre québécois, avait commencé à décorer les murs de sa demeure avec un bestiaire d'êtres étranges tout droit sortis de son imagination. A l'époque, il se donnait quinze ans pour devenir célèbre, un pari réussi puisque sa petite maison fut transférée vers l'ancienne Pulperie de Chicoutimi. Arthur Villeneuve, décédé quatre ans auparavant n'aura pas assisté à ce déménagement mais savait qu'un jour où l'autre, celui-ci aurait lieu. Un déménagement à grands frais qui aura couté un million de dollars de l'époque (dont 450 000$ pour l'acquisition et les droits d'auteur, le reste de la somme couvrant le transport, la restauration et la mise en valeur) aux contribuables. Enfant du pays, Arthur Villeneuve est connu pour ses peintures naïves dont il recouvrira l'intérieur, puis l'extérieur de sa maison à partir de 1957, oeuvrant 23 mois durant et jusqu'à cent heure par semaine pour réaliser son projet. Et d'ouvrir sa demeure au public en 1959.
INFOS PRATIQUES :
|