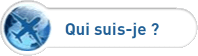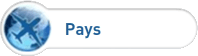Revoir le globe

|
De Sept-Îles au Havre Saint-Pierre
(Québec, Canada) |
|
Mercredi 16 mai 2018
Je poursuis mon périple sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent après m'être arrêté à Sept-Îles. Ma destination est cette fois le Havre Saint-Pierre. Plus de 200 kilomètres séparent ces deux communes reliées par la route 138 Est, qui longe plus ou moins la côte à cet endroit. Le paysage qui n'est pas exceptionnel offre des forêts boréales de sapins et plus rarement des zones de tourbière. Ce matin, le temps est ensoleillé et le ciel s'est paré de bleu mais, côté température, on oscille entre 0 et -1°, avec un vent glacial. Au km 1088, se trouve la rivière Manitou (ci-dessous en photo) : un kiosque touristique, encore fermée actuellement, est le point de départ d'un sentier forestier qui conduit aux chutes de la rivière. L'endroit est toujours enneigé et je ne me hasarderai pas à emprunter ce sentier aujourd'hui.
Cette promenade en forêt en période estivale est très agréable et les rivières qu'on y rencontre sortent de l'ordinaire. La rivière Manitou se trouve à une vingtaine de kilomètres du village de Sheldrake, le village de Rivière au Tonnerre se trouvant encore huit kilomètres plus loin, sur la même route. J’aperçois bientôt le pont Touzel, un pont métallique qui me laisse entrevoir la rivière Sheldrake (ci-dessous) sur ma gauche, et le Saint-Laurent (la mer, comme disent certains, ici) sur ma droite. Il est apparemment possible de remonter la rivière sur plusieurs kilomètres afin d'observer de superbes chutes d'eau, d'où l'utilité de partir avec son canot sous le bras.
Je roule au pas (à 50 km/heure) lors de la traversée des localités car on ne plaisante pas avec la sécurité au Québec, et des véhicules de police procèdent à des contrôles de vitesse de temps à autre. J'atteins bientôt Rivière au Tonnerre, un village de 280 âmes, qui est célèbre pour sa voûte d'église entièrement sculptée par les villageois d'alors ...au couteau de poche ! Le village tire son nom d'un phénomène naturel. En effet, la rivière au Tonnerre, qui coule sur la commune, offre aussi à cinq kilomètres de son embouchure plusieurs hautes cascades (d'environ 50 mètres) dont le fracas fait penser à un coup de tonnerre. Certains habitants donnèrent même à l'endroit l'appellation de Boum boum river. C'est dire ! Je me rends donc à l'église (ci-dessous) mais celle-ci est fermée (voir infos pratiques). Je tente de joindre quelqu'un dans une maison voisine. Une charmante dame m'informe que son frère connait bien l'histoire de ce lieu de culte et m'invite à la rencontrer. Je ferai ainsi connaissance d'Ivan Bezeau, qui est passionné par l'histoire de sa commune mais également du Québec tout entier. Et de me dénicher les informations que je recherchais : j'apprends d'abord qu'une première chapelle sera érigée par les résidents de Rivière au Tonnerre en 1875, juste quelques années avant le grand incendie qui détruisit tout le village (en 1882). Une seconde chapelle sera construite en 1891, puis le père eudiste, normand d'origine, Joseph-Louis Hesry, tracera les plans de l'église actuelle en 1903 donnant à la construction un style architectural normand. Les travaux débuteront deux ans plus tard avec l'aide bénévole de tous les paroissiens de l'époque. La voûte de l'édifice comporte quant à elle une soixantaine de motifs dont quarante furent réalisés au couteau de poche par quelques artisans, dont James Boudreau, auteur des dessins variés. Le visiteur peut ainsi admirer, pourvu qu'il lève les yeux, des colonnettes de 45 centimètres de diamètre semblant ne former qu'une seule pièce alors qu'il s'agit en réalité d'arbres mesurant de quinze à vingt centimètres de diamètre qui furent recouverts de minuscules planchettes travaillées à la hache, à l'herminette puis rayées au bouvet. Les voûtes centrales, elles, forment une suite de caissons creux quadrangulaires munis de côtés renversés en angle de 45° environ. Au-dessus des bas-côtés, se trouvent des voûtes semi-cylindriques, offrant une impression d'espace. La performance de ces sculptures résident aussi dans le fait que les sculpteurs utilisèrent des instruments aussi variés que la hache, la hachette, l'herminette, les couteaux de poches et le bouvet (pour tracer les rainures en fin d'ouvrage). Il faut enfin savoir que l'église de Rivière au Tonnerre fut une œuvre collective et bénévole, entièrement financée par les dons de bienfaiteurs. Autre curiosité de la voûte de l'édifice : les armoiries de Mgr Gustave Blanche, eudiste, premier préfet apostolique et premier évêque du Golfe-Saint-Laurent. Là encore, James Boudreau sera à pied d'oeuvre pour réaliser ces armoiries qui sont visibles au-dessus de la statue du Sacré Coeur, dans le premier caisson de la voûte situé au-dessus de l'ancien autel. Au bas de l'écusson, on remarque un petit bateau qui rappelle les nombreux voyages de l'évêque, puis, à gauche, une longue pointe de rocher s'avançant dans le fleuve et représentant les nombreuses baies qui garnissent les rives du golfe. La longue croix visible symbolise la vocation des missionnaires d'antan. Vers le haut, on aperçoit un petit fort, symbole de la prise de possession de la Côte-Nord par les missionnaires. En bas et à gauche, on peut distinguer un groupe de Montagnais, en face d'une bûche de bois en train de flamber et en diagonale, on remarque une large bande coupée de lignes transversales représentant les obstacles à vaincre pour mener à bien l'oeuvre civilisatrice et missionnaire des eudistes. Voici un lieu qui mérite une visite !
En discutant avec des habitants, j'apprendrai que la saison touristique sur cette froide Côte-Nord se résume à seulement quelques mois (de mi-juin à fin septembre) car la neige revient ici dès le mois d'octobre. Sous un soleil radieux, j'observe au loin les îles du parc national de l'Archipel de Mingan, l'un des quatre parcs nationaux du Canada situés au Québec. On y voit un chapelet d'îles calcaires au large du Havre Saint-Pierre et en face de l'île d'Anticosti. Là, se dressent d'étranges monolithes aussi surnommés « pots de fleurs » (ci-dessous) et une végétation de type boréal. Quant aux eaux entourant ces îles, elles offrent à la fois une intense vie marine et de nombreux oiseaux, dont la macareux moine (deuxième photo) qui niche sur certains îlots. Le présent archipel, connu depuis le 17è siècle, doit son nom à plusieurs origines : pour certains, Mingan viendrait du mot montagnais maikan (loup des bois) et pour d'autres, il s'agirait d'un nom d'origine bretonne, contenant le mot men (pierre), dont Menguen (la pierre blanche). Finalement, on s'accorderait à reconnaître l'origine basque du terme, signifiant « flèche en pointe de sable » qui décrit la pointe où est située Longue Pointe de Mingan. Le parc national comprend ainsi plus de mille îlots et cayes (îles basses formées de sable et de corail) localisés le long de la Côte-Nord, de Longue Pointe de Mingan à l'embouchure de la rivière Aguanish, sur une distance totale de 150 km. Ces îles furent accordées en 1679 à Louis Jolliet par Frontenac, le gouverneur de la Nouvelle-France nommé par le roi de France Louis XIV, pour y pratiquer la pêche à la morue et la chasse au phoque. Ces îles deviendront la propriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson à partir de 1836, jusqu'à leur acquisition par Dome Petroleum Ltd en 1979. Et l'endroit de devenir parc national en 1984.
INFOS PRATIQUES :
|