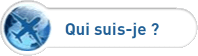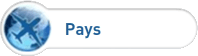Revoir le globe

|
Du Cap-Chat à La Martre
(Gaspésie, Québec, Canada) |
|
Mardi 22 mai 2018
Je quitte Matane pour remonter en Haute-Gaspésie avec trois localités : Cap-Chat, Saint Anne des Monts et La Martre. La localité de Cap-Chat fut fondée en 1884. Elle regroupe aujourd'hui environ 3000 Cap-Chatiennes et Cap-Chatiens répartis sur plus de 183 km2. Ce nom de Cap-Chat m'interpelle. Pourquoi avoir donné à cet endroit un tel nom ? Il semblerait que ce nom soit lié au rocher Cap-Chat qui ressemblerait tout simplement à un chat. Une légende de la tribu indienne micmac raconte qu'un chat sauvage (peut être un raton-laveur?) qui se promenait sur la grève, dévorait des animaux se trouvant sur son passage. Un jour, la fée-chat accusa celui-ci d'avoir dévoré sa progéniture et le transforma en rocher pour l'éternité. D'autres prétendent qu'il s'agirait plutôt d'une déformation du nom d'Aymar de Chaste, lieutenant général de la Nouvelle-France au début de la colonie. Située à l'entrée ouest de la Haute-Gaspésie, Cap-Chat offre plusieurs paysages aux visiteurs de passage : le marais salé de la Baie des Capucins ravira les ornithologues mais aussi les amateurs d'autres espèces animales et végétales.
Du haut des collines entourant Cap-Chat, un autre parc attire mon attention : le Nordais, premier parc éolien implanté en Gaspésie, est impressionnant avec ses dizaines d'éoliennes dont une est très particulière, puis q'il s'agit d'une éolienne à axe vertical et la plus haute du monde. A ma grande surprise, aucune information n'est affiché sur place, ni période d'ouverture, ni horaires de fonctionnement, et encore moins de panneaux d'information expliquant les technologies exploitées par ce type de machines. Inauguré en 1988 par Hydro-Québec qui effectuait des recherches sur l'énergie éolienne, ce projet Éole reste le pionnier du développement de cette source d'énergie dans la belle province. Sans aucun doute, l'éolienne à axe vertical (ci-dessus en photo) est la vedette du parc avec ses 110 mètres de haut et sa puissance de 1,3 MW, soit le double de puissance des autres éoliennes. Le parc Nordais dispose au total de 133 éoliennes réparties entre Cap-Chat et Matane. Ces éoliennes standard (d'une hauteur de 55 mètres) peuvent produire jusqu'à 750 kW par période de grands vents, soit 100 MW en tout pour l'ensemble des éoliennes, faisant de l'ensemble un parc rentable. Quant à l'éolienne géante, une visite guidée de l'endroit, dans sa partie basse où se trouve l'essentiel de la machinerie, permet d'en apprendre plus sur cette centrale d'énergie. Le Québec exploite de nombreuses éoliennes sur son territoire, comme, par exemple à la Biosphère de Montréal (où deux éoliennes sont installées sur la plus haute plateforme de l'édifice), même si, comme en France, l'installation de ces machineries géantes est loin de faire partout l'unanimité. Certains contestent également la fiabilité de l'éolienne, même si celle-ci produit généralement l'énergie suffisante (chauffage inclus) pour une maison de 4 à 5 personnes. Son prix de revient (près de 10000$ pour l'achat plus 10000$ de frais d'installation) est certes conséquent mais permet la revente du surplus d'électricité à Hydro-Québec lors des périodes de basse consommation du foyer. Reste à calculer l'impact sur le tourisme...
Non loin de là, et toujours le long de la route 132, je m'arrête au phare de Cap-Chat (ci-dessus) : les gardiens de phare se sont succédé ici pendant plus d'un siècle. Le premier d'entre eux fut Joseph Roy, confirmé dans ses fonctions en août 1871, quelques jours après l'inauguration du premier phare, et son salaire annuel était alors de 300$. Lorsqu'il mourut en 1874, il fut remplacé par Louis Treflé Côté, au mois de septembre de la même année. Ce gardien-là restera en poste 27 ans durant et sera remplacé par son fils Luc, qui, lui aussi, occupera cet emploi un quart de siècle, jusqu'en 1927. Pour la famille Côté, ce phare restera une histoire de famille puisque le fils de Luc Côté, J-A.Aurèle, y deviendra gardien à son tour, mais jusqu'en 1931 seulement, suite à son décès prématuré. Son successeur, Jean-François Roy restera en poste 33 années durant, jusqu'en 1964. Lui succéderont J.Marcel Duguay, Yves Duguay, puis Charles-Hector Fraser qui sera le dernier gardien du phare. Notre homme avait préalablement été gardien de phare à l'île Corossol, au large de Sept-Îles. Le phare Cap-Chat sera construit à la suite du nombre élevé de naufrages dans le secteur, durant la seconde moitié du 19è siècle. La région avait ainsi connu cinq naufrages entre les seuls mois d'octobre à décembre 1845. Il faudra toutefois attendre 1868 pour que le parlement canadien cautionne l'aménagement de nouveaux phares dans le Saint-Laurent, dont celui de Cap-Chat. Ce premier phare mesurera environ onze mètres de haut et sera mis en service le 11 août 1871. Entièrement blanche et de forme carrée, sa structure s'élevait à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son feu était visible à une distance de 18 miles (29 km) et était produit par six brûleurs produisant un éclat toutes les trente secondes. Un détail cependant : ce premier phare étant situé 438 mètres à l'ouest de l'édifice actuel, sa lumière était en partie obstruée par la pointe de Cap-Chat pour les bateaux naviguant vers l'Est. Pour cette raison, et à la suite de l'échouage d'un navire en provenance de Londres en 1874, on décida de bâtir un deuxième phare à quelques mètres seulement du bâtiment actuel. Ce dernier entrera en fonction dès 1875, et trente années s'écouleront avant que la nécessité d'ériger un nouvel édifice ne s'impose. Entre temps, le trafic maritime sur le fleuve s'était considérablement accru et il devenait indispensable d'améliorer les équipements des phares. Et le troisième phare de voir le jour en septembre 1909, constitué d'une tour en béton de dix mètres, surmontée d'une lanterne circulaire en fer d'un diamètre de trois mètres. Et le résultat des améliorations des lentilles et des lampes de lui conférer une luminosité cinq fois plus puissante (l'équivalent de 100000 bougies!), une lumière blanche produisant des éclats d'un quart de seconde tous les trois secondes, chaque éclat étant séparé par une période d'obscurité de 2,75 secondes. En 1961, l'installation d'une lampe électrique à incandescence de 1000 watts rendra caduque l'utilisation de l'ancien brûleur à vapeur de pétrole. Puis, en 1970, fut installée une lampe électrique à vapeur de mercure de 400 watts, juste avant l'électrification du système, quelques temps plus tard, permettant à la lumière du phare de fonctionner 24 heures sur 24. 1988 verra enfin l'automatisation de l'ensemble, qui mettra un terme à l'intervention du gardien.
A une dizaine de kilomètres de là, se trouve Sainte-Anne-des Monts, située entre mer et montagnes, entre le fleuve Saint-Laurent et les monts Chic-Chocs, village qui se développa autour de la rivière Sainte-Anne. Par beau temps, on peut y admirer baies, rochers et falaises et apprécier la beauté toute particulière des paysages. Au début, les habitants vivront de la mer (pêche au saumon) et de l'industrie forestière. Dans le passé, l'endroit accueillit successivement les bateaux des Vikings, les pirogues des Indiens et les navires de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain. Puis la ville naquit officiellement en 1662, lorsque Louis XIV, le roi de France, concédera à Jacques et Denys de la Ronde deux rivières du secteur Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts. Côté tourisme, c'est le calme plat avant la saison qui débutera en juin. Même Exploramer est fermé. Cette institution muséale offre de découvrir l'univers des poissons, crustacés et autres mollusques du Saint-Laurent, avec ses bassins tactiles, ses guides naturalistes et ses excursions. Une vraie leçon de choses pour petits et grands ! Sainte Anne des Monts est aussi l'une des portes d'entrée pour le parc national de la Gaspésie (ci-dessus). Les monts Chic-Chocs y culminent à 1270 mètres, au mont Jacques Cartier. Cet espace de 802 km2 renferme à lui seul des paysages étagés permettant de passer de la forêt boréale à la toundra arctique, selon l'altitude et l'exposition aux vents. Fait unique au Québec, on peut y assister à la cohabitation de troupeaux de caribous avec des cerfs et des orignaux. Coyotes, castors et renards roux sont également nombreux, d'autant plus que ces espèces sont protégées et que nul ne peut les chasser ici. Quant au centre d'interprétation, il est situé au pied du Mont Albert et offre les clefs pour comprendre ce fantastique milieu naturel.
Luxueuse résidence de style Regency, la maison Théodore Jean Lamontagne (ci-dessus) fut érigée en 1871 et 1873. Celle-ci se compose d'un corps de logis de plan rectangulaire coiffé d'un toit à croupes percé de lucarnes et aux larmiers saillants, sans oublier une annexe à l'arrière. L'ensemble s'élève sur un promontoire surplombant le Saint-Laurent et la petite ville de Sainte Anne des Monts. Entrepreneur habile et prospère, Théodore Jean Lamontagne occupera une place particulière dans le développement local au 19è siècle. Il s'installera d'abord à Cap-Chat en 1851 puis travaillera pour la William Price Company avant de fonder sa propre entreprise dans le domaine de la pêche, du bois et du commerce de gros et de détail, vers 1864. Son magasin fournira ainsi 5000 des 7635 quintaux de morue produits dans la région dès 1870. C'est dire le succès de ce commerce. Notre homme fera alors construire cette splendide demeure qui fut habitée par ses descendants jusqu'en 1930, dont sa petite-fille, Blanche, considérée comme la première poétesse du Québec et un personnage important dans la littérature canadienne-française. Aujourd'hui, la maison, classée comme bien national depuis 2012, fait office d'auberge.
Autre lieu, autre phare, avec celui de La Marte, en photo ci-dessus. Le petit village apparut d'abord sous l'impulsion d'une mission dédiée à Saint-Martial, débouchant sur la paroisse de Sainte-Marthe-de Gaspé. Puis, le village sera plus tard rebaptisé Rivière-à-la-Martre avant de prendre finalement le nom de La Martre, en raison des nombreuses martres vivant jadis dans cette région. L'église paroissiale sera construite en 1914, seule église de Gaspésie à être revêtue de bardeaux de cèdre. Quant au phare, il brilla pour la première fois en juin 1876 pour offrir une sécurité maritime aux navires entre les phares de la Madeleine et de Cap-Chat. Le tout premier phare s'élevait sur la maison du gardien et s'élevait à 16,50 mètres au-dessus du sol. La tour du phare actuel, elle, fut érigée en 1909. Le site du phare offre une boutique de souvenirs (anciennement maison du gardien) et l'ancien bâtiment du criard de brume abrite maintenant une exposition permanente consacrée à l'histoire de la signalisation maritime.
INFOS PRATIQUES :
|