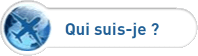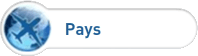Revoir le globe

|
Villages de Provence - De Vaugines à la Tour d'Aigues
(Vaucluse, France) |
|
Mardi 20 décembre 2011
Pour mon dernier jour dans le Luberon, j'ai choisi de me rendre à Vaugines, petite village situé à seulement deux kilomètres de Cucuron. Vaugines se trouve à 400 mètres d'altitude, au pied du Luberon. Village agricole à l'écart des routes fréquentées, d'un peu plus de 500 habitants, ce village a révélé des traces préhistoriques. On y a retrouvé en effet des outils et des poteries. Les habitations sont alors regroupées sur des hauteurs (oppida). Puis, à l'époque romaine, Vaugines connait une époque de paix et les habitations, au lieu d'être concentrées, se dispersent et prennent la forme d'exploitations agricoles. A cette époque, on y travaille déjà la vigne. La chrétienté est présente très tôt dans le village car on a retrouvé un autel paléochrétien (photo ci-dessous) qui se trouve dans l'église Saint Barthélémy (deuxième photo). En 1004, l'abbaye de Psalmody reçut le territoire de Vallis Amata pour y fonder un monastère. Une petite bâtisse est d'abord créée au XI ème siècle, qui est dédiée à Saint Sauveur. Lorsque Vaugines s'agrandit, deux siècles plus tard, la chapelle fut élevée au rang de paroisse sous le nom de Saint Pierre et fut agrandie à cette occasion.
Cette paroisse est à nouveau remaniée au XVIè siècle et l'église prend alors le nom de Saint Barthélémy. Elle restera parfois mal entretenue et même fermée durant une quarantaine d'années en 1945. Elle échappera de justesse à la destruction au XIXè siècle. Après 1950, le Père Combaluzier et l'association « Le Trestoulas » restaurent l'intérieur de l'église ( de 1988 à 1990) et aménagent les abords du bâtiment. Aujourd'hui, on peut admirer la nef ( photo ci-dessous) magnifiquement mise en valeur avec les statues de Saint Barthélémy et de Saint Louis et bien sûr le Christ sur la croix. De nombreuses photos peuvent être vues dans l'album Europe de la section Médiathèque de ce site.
Une autre chapelle existait jadis à Vaugines: La Chapelle Saint Joseph. J'ai eu quelques difficultés à la trouver car elle a désormais été transformée en...bibliothèque municipale. L'intérêt réel de ce bâtiment réside dans son cadran solaire, le plus beau de Vaugines (photo ci-dessous), côté Place Capello. Ce triple cadran solaire a été peint par un certain Monsieur Nielsen et donne trois heures, de gauche à droite: L'heure d'été , l'heure solaire et l'heure d'hiver. Un autre cadran solaire peut être observé sur le mur d'une maison au 127 rue de Rompe Cuou. On trouve plusieurs cadrans solaires à Vaugines mais quoi de plus naturel, dans un village qui baigne sous le soleil une bonne partie de l'année? Depuis longtemps, l'église paroissiale était jugée incommode et peu adaptée pour les prêtres et les habitants du village On construisit alors, en 1730, une première chapelle dans le village pour un usage quotidien. Puis celle-ci disparaît. En 1873, Joseph Bec, un particulier, lègue une maison et une somme de mille francs afin de faire construire une chapelle dédiée à Saint Joseph. Et une souscription permit finalement d'ériger cette chapelle. Elle deviendra bibliothèque municipale en 1988. Il reste encore à l'intérieur un bénitier et la grille d'autel.
Je remonte vers la Place de la Mairie ou trône une fontaine (photo) ainsi que l'hôtel de ville (deuxième photo). Pendant des siècles, Vaugines s'ordonna au-dessous du château (qui a depuis disparu), entre la rue Haute et la rue Basse, autour de la Place des Aires, la création d'une nouvelle place au milieu du XIXè siècle déplace le centre vital du village. L'hôtel de ville est construit en 1845-1846 d'après des plans conçus par l'architecte du département. L'horloge (troisième photo) coiffera le bâtiment en 1846 dans un beffroi construit à son sommet et recouvert d'une toiture de plomb afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans les mécanismes de l'horloge. La partie inférieure de la bâtisse sera occupée par l'école de garçons à la fin du XIXè siècle, puis par le bureau des Postes et Télécommunications jusqu'en 1971 avant de devenir une épicerie.
Je passe maintenant devant la Commanderie (photo ci-dessous) située rue des Amazones. Deux parties sont visibles: L'aile est de la maison, appelée Manoir et bâtie au XVIè siècle par Georges de Bouliers , prieur et seigneur de Vaugines de 1508 à 1548. Et puis, la vieille maison, qui fut construite au XVIIè siècle par les descendants de Georges de Bouliers. Cette maison demeurera dans la famille de Bouliers puis dans celle des Toppin ( leurs descendants) excepté entre 1724 et 1787, date à laquelle elle fut vendue aux Bruny. La porte d'entrée (deuxième photo) ainsi que les fenêtres à meneaux et la majestueuse façade sud (troisième photo) sont remarquables.
Nous l'avons vu, il y avait jadis un château à Vaugines. Il ne reste aujourd'hui que son emplacement sur une butte du village. La fondation du château fut pourtant liée à celle du village et remonte à la fin du XIIè siècle,ou début XIIIè siècle. En 1317, les deux co-seigneurs de Vaugines, le prieur et le baron d'Ansouis, Elzéar II de Sabran, concluent un accord qui laisse la possession du château au prieur. Au XVIè siècle, les autres prieurs, dont Georges de Bouliers, entreprendront de nombreux travaux sur la bâtisse mais celle-ci sera délaissée le jour où elle passera entre les mains de seigneurs laïcs. Le château retournera à la famille de Bouliers en 1680 et sera plus tard racheté par François de Bruny qui le laissera à l'abandon. La Révolution française aura raison de ce pauvre château.
Depuis la Place de la Mairie, je monte en direction de la rue des Grottes (photo), qui servit probablement de refuge aux hommes pendant la Préhistoire. La zone ne fut construite que vers 1630 afin de faire face à l'augmentation de la population. Jusqu'au Xxè siècle, les habitations furent adossées à la falaise de Poucelles, côté nord et les animaux étaient logés dans des appentis côté sud. Progressivement, ces appentis furent remplacés par des maisons et une fontaine fut construite en 1880.
Au bout de la rue des Grottes, j'aperçois un oratoire consacré à Saint Joseph (photo). C'est l'oratoire le plus ancien de Vaugines, daté de 1852. Un autre ,dédié à Saint Barthélémy est situé au début du chemin de Roquerousse. Un autre oratoire avec la Vierge et l'enfant se trouve à l'est, sur la colline de Caillones.
Je quitte Vaugines pour la Tour d'Aigues, situé à quelques kilomètres de là. Situé dans le sud du Luberon, cette petite ville est bordée par la rivière Eze. Vouée à l'agriculture et à la viticulture, La Tour d'Aigues possède aussi un château comme vous n'en verrez pas beaucoup dans votre existence: Le château de la Tour d'Aigues ( ou plutôt ce qu'il en reste) (photo ci-dessous) arbore encore ses élégantes façades du XVIè siècle mais surtout héberge dans sa veste cour le Festival anneul du Sud Luberon, et dans ses caves, un musée de la faïence et un musée-exposition sur l'histoire du pays d'Aigues. C'est en 1002 puis en 1018 que l'on trouve les plus anciennes mentions d'un « turris » qui donnera son nom au village. Les puissants comtes de Forcalquier possèdent alors une fortification permettant de surveiller la plaine de Pertuis dans la vallée de la Durance, le Luberon et les Alpes. C'est autour de cette tour que se crée peu à peu le village. De ce premier « château », il ne reste rien désormais si ce n'est un quartier dénommé du Château Vieux. Un nouveau château sera érigé à quelques dizaines de mètres du premier probablement au XIVè siècle. Au début du XVIè siècle, toute la partie sud du château médiéval est abattue et laisse place à une superbe façade, dont on aperçoit toujours aujourd'hui les deux tours d'angle et le triomphal portail d'entrée (deuxième photo). A partir de 1550, le Baron Jean-Louis Nicolas a pour ambition de moderniser les lieux. Naît ainsi le château « Renaissance » , l'un des plus beaux exemples de style Renaissance en Provence, qui accueillera en 1579 Catherine de Médicis.
Revenons sur le portail d'entrée. Il est l'œuvre de l'architecte piémontais Ercole Nigra , fut construit à partir de 1566 et son style sera inspiré de la provence romaine (tout comme l'arc de triomphe d'Orange). La fin des travaux interviendra en 1571. Erigé en forme d'arc de triomphe antique, avec deux niveaux séparés par une large frise ornée et encadrée par de hauts pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens qui supportent un entablement surmonté d'un grand fronton triangulaire, ce portail est majestueux. Les deux niveaux bénéficient d'une grande baie centrale, et de niches ou baies secondaires. Au centre, l'entrée porte sur la clef de l'arcade, une figure du dieu Mars , casqué et armé et, de part et d'autre, des victoires ailées brandissant des étendards. La grande frise est un mélange de thèmes d'inspiration antique et renaissance avec des trophées, armes, et attributs guerriers (boucliers, cuirasses, casques, glaives, carquois, flambeaux, cartouches et cuirs...) Le fronton porte des frises de trèfles et des fleurons, des denticules, chapelets, oves et dards,rosaces à caissons et mufles de lions. C'est la partie la plus originale du château et celle qui est la mieux conservée. Ci-dessous, une carte postale représentant le château de la Tour d'Aigues au XVIIIè siècle.
Au cours de ces derniers jours, j'ai pu apprécié le charmant accueil de la population du Luberon. J'ai toujours trouvé l'aide nécessaire à la bonne réalisation de mes photos et de mes reportages. Souvent, on me conduisit sur le lieu que je recherchais en m'expliquant le contexte historique. Ici, on aime sa région et on est content de la faire visiter. Comment pouvais-je passer dans la région sans descendre à Marseille? Ca tombe bien, je souhaite y faire quelques courses car j'ai entendu dire qu'il y avait là-bas un magasin d'usine de la marque de sous-vêtements HOM, marque marseillaise par excellence. Nous voici partis, Lionel et moi en direction de l'autoroute du Soleil avec pour compagnon de voyage, le GPS de mon iphone. Là encore, l'accueil est chaleureux, les gens parlent naturellement avec vous. Rien à voir avec la morosité parisienne. Puisqu'il faut acheter français, achetons français! D'autant plus que l'endroit vaut le déplacement (voir infos pratiques). Sur le chemin du retour, nous passons par le centre-ville mais nous trouvons très vite bloqués dans des embouteillages. Moi qui suis habitué à l'ordre et à la propreté tokyoite, je me retrouve soudain sur une autre planète. Une joyeuse anarchie règne dans la seconde ville de France, où les rues se croisent et se décroisent parfois si bizarrement qu'on se demande à quelle époque remonte le dernier plan d'urbanisation. On aime Marseille ou on n'aime pas. Les inconditionnels de cette cité vous le diront!
INFOS PRATIQUES:
|