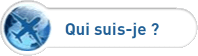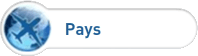Revoir le globe

|
Le Musée des Maisons Royales
(Saint-Domingue, République Dominicaine) |
|
Samedi 15 juin 2013
Je ne pouvais pas repartir de Saint-Domingue sans visiter le Musée des Maisons royales. Les hauts murs de l'édifice furent bâtis au XVI ème siècle dans le style plateresque afin d'abriter les corps institutionnels de la couronne espagnole comme l'audience royale, la comptabilité royale, le Palais des gouverneurs et des capitaines généraux. L'endroit servira de résidence au gouverneur français, Jean-Louis Ferrand à la fin du XVIII ème. Il abritera également le gouvernement dominicain, l'école des Beaux arts et des administrations d'Etat. Le musée qui s'y trouve désormais fut inauguré le 31 mai 1976 en présence du roi Juan Carlos d'Espagne et de la reine Sophie. La construction fut lancée sur l'ordre de la couronne espagnole qui était alors représentée par le roi Ferdinand II d'Aragon, le 5 octobre 1511. Le but était alors d'abriter les administrations gouvernementales de la colonie à l'intérieur de deux bâtiments reliés entre eux (d'où le nom pluriel de maisons royales). L'aile sud accueillait l'audience royale qui formait le premier tribunal du Nouveau Monde (deuxième photo ci-dessous). On y trouvait aussi le bureau du contrôleur général. La deuxième section (aile nord), elle, abritait les vice-rois, les gouverneurs et les capitaines généraux.
La structure architecturale d'antan subit des changements depuis l'époque coloniale. Ainsi Jean-Louis Ferrand, alors gouverneur français, donna t-il à la façade un aspect architectural classique en 1807. Cinq ans auparavant, ce général faisait partie de l'expédition de Saint-Domingue lorsque la France voulut soumettre l'île en moins de quatre mois. Une insurrection éclata cependant en 1802 et la fièvre jaune emportait le Général Leclerc. Ferrand se retrouva donc en charge de défendre la partie française de la colonie. Ces maisons royales furent aussi utilisées comme siège gouvernemental sous la présidence de Carlos Felipe Morales. Rafael Trujillo y apporta également d'autres modifications afin d'y installer des bureaux et une vaste collection d'armes et d'armures, toujours présente aujourd'hui (ci-dessous). L'ensemble sera restauré dans son aspect d'origine en 1973 sous l'administration du Président Joaquin Balaguer et l'on décidera d'y faire un musée pour mettre en évidence l'histoire, la vie et les us et coutumes des habitants de la colonie espagnole. Le musée n'ouvrira toutefois ses portes au public que trois années plus tard.
Le musée comporte deux niveaux : Le rez-de-chaussée et le premier étage. La première salle du rez-de-chaussée aborde la conquête, la colonisation et l'évangélisation de l'île Hispaniola. Deuxième île des Antilles par sa taille (après Cuba),celle qui s'appelle aujourd'hui Saint-Domingue aurait porté plusieurs noms selon les Indigènes de l'époque. Christophe Colomb fut d'abord frappé par la ressemblance de ses paysages avec ceux de l'Espagne et il la baptisa l'Espanola. C'est en 1502, qu'on rebaptisa l'île sous le nom de Saint-Domingue. Quatre ethnies de la familles des Arawaks peuplaient alors les lieux et vivaient de l'agriculture et de la pêche. La colonisation espagnole ne débutera que plusieurs mois après l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île en 1492, lors d'un deuxième voyage. Et Hispaniola de devenir rapidement le point d'appui pour les expéditions exploratrices et colonisatrices espagnoles aux Amériques. En 1494, les Espagnols fondent la ville La Isabela au nord de l'île. Puis, deux ans plus tard, la ville Nueva Isabela sur la rive orientale du fleuve Ozama. En 1500, Francisco de Bobadilla, un nouveau gouverneur, est nommé sur l'île et fait aussitôt jeter les Colomb en prison en les accusant de mauvaise gestion. En 1502, un cyclone ravage la ville qui est reconstruite sur l'autre rive du fleuve tandis que Bobadilla se voit remplacé par Nicolas de Ovando. Cette nouvelle ville est alors baptisée Santo Domingo de Guzman. Les Indiens se révoltent très vite et Nicolas de Ovando leur oppose une riposte si sanglante qu'elle contribua à en diminuer le nombre. Le nouveau gouverneur décide alors de faire venir les premiers esclaves noirs d'Afrique et de leur imposer la langue espagnole et des prénoms espagnols. Le 20 décembre 1503, la reine Isabelle signe un décret légalisant la répartition des Indiens entre les colons espagnols. Devant la situation économique préoccupante de l'île, De Ovando est rappelé en Espagne et Diego Colon est nommé gouverneur à sa place en 1508. En 1511, la première Real Audencia espagnole est instituée pour l'île de Saint-Domingue. 1522 est l'année de la première révolte d'esclaves qui travaillent dans une plantation de canne à sucre. Dès 1530, l'île n'envoie pratiquement plus d'or en Espagne et la production sucrière devient la première richesse du territoire. Peu à peu délaissée par les Espagnols, la partie occidentale de l'île est bientôt convoitée par les flibustiers français, anglais ou néerlandais. Le roi Philippe II décide alors de mener une politique de terre brûlée dans cette partie de l'île mais cela a pour effet de laisser le champ libre aux boucaniers qui ravitaillent en viande les flibustiers des îles voisines. Avec les années, la France reprendra progressivement l'avantage face aux Anglais. La colonisation française sera officiellement reconnue par Louis XIV en 1665. Le cuir et le tabac (déjà cultivé par les Taïnos) deviennent les principales richesses. Le sucre, lui, reprend son essor grâce à l'apport d'une nouvelle main d'oeuvre d'esclaves rapportée d'Afrique à partir des années 1700.
Le musée aborde également les Rois catholiques qui vont faire l'Espagne, puis les conquêtes : Rois catholiques est aussi un titre endossé par Isabelle 1ère de Castille et Ferdinand II d'Aragon, qui fut accordé par le Pape Alexandre VI. Leur mariage secret en 1469 donne naissance à l'union des couronnes de Castille et d'Aragon en 1474. On dit qu'Isabelle de Castille aurait vendu ses bijoux afin de financer le voyage de Christophe Colomb en Inde par une nouvelle route vers l'ouest, qui l'amena finalement à découvrir les Amériques le 12 octobre 1492. Les fonds provenaient en réalité de Luis de Santangel, alors chancelier de la maison royale, de Gabriel Sanchez, trésorier d'Aragon et d'Isaac Abravanel (le financier juif le plus célèbre d'Espagne). Ces Rois catholiques avaient proclamé que les Espagnes devaient devenir plus catholiques encore que le pays mère du Vatican, l'Italie. A la suite de la Reconquista, ils expulsèrent donc les Juifs qui refusaient de se convertir puis abrogèrent les accords signés en 1492 avec Abu Abdil-lah, dernier roi de l'Emirat de Grenade. Au nombre des hommes de la découverte, on trouve les frères Pinzon : Martin Alonso , Francisco et Vincent. Martin et Vincent piloteront la Nina et la Pinta, deux des trois bateaux qui partirent à la conquête du Nouveau Monde sous les ordres de Christophe Colomb. D'autres hommes participeront aussi aux expéditions lancées depuis Saint-Domingue, à partir de la fin du XV ème siècle : Francisco de Bobadilla sera par exemple gouverneur des nouveaux territoires d'Amérique, à la place de Christophe Colomb, en 1499. Il accélèrera l'Encomienda (regroupement d'Indigènes) des Indiens tout en distribuant les terres aux colons. C'est lui qui incarcérera les Colomb pour mauvaise gestion. Il périra quelques années plus tard en mer, dans un ouragan. Nicolas de Ovando, noble espagnol et soldat, succèdera à Francisco de Bobadilla en 1502. Très apprécié de la reine Isabelle de Castille, il embarque en effet pour le Nouveau Monde le 13 février 1502, accompagné d'une flotte de trente navires. Il trouvera les Indigènes en pleine révolte lors de son arrivée à Hispaniola et devra mater la rébellion sans états d'âme. Il restera gouverneur pendant cinq années, jusqu'en 1509, puis sera remplacé à son tour par Diego Colon. On trouve aussi des noms comme Sebastian de Ocampo, Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda, Martin Fernandez de Enciso...parmi ceux qui contribuèrent aux fameuses expéditions exploratrices.
Des pièces aménagées comme autrefois permettent aux visiteurs du musée des maisons royales d'imaginer ce qu'était l'existence du temps des conquistadores : La salle d'audience (le tribunal) était l'endroit où l'on jugeait les hommes accusés de vols ou de meurtres. C'est là qu'on administrait la Justice. Les accusés, tout comme d'ailleurs les membres du jury, attendaient leur tour dans l'antichambre de l'audience royale (photo ci-dessus). Tout près se dresse encore le grand salon du trône et des réceptions, appelé également le salon des gouverneurs et des capitaines généraux (ci-dessous). Un bureau des capitaines généraux existe toujours aujourd'hui (deuxième photo ci-dessous). La capitainerie générale était chargée, dans une zone géographique déterminée, de veiller au bon déroulement des opérations militaires engagées sur le terrain : Approvisionnement en vivres et en armes et recrutement des hommes. Il lui fallait aussi ériger des campements et des hôpitaux militaires, des fortifications, des forts, des poudrières et des murailles.
La salle de législation (ci-dessous) était la salle où l'on créait les lois. Une autre salle expose des répliques de meubles de l'époque coloniale d'un bureau de comptable (deuxième photo). Au rez-de-chaussée, je découvre une salle réservée à la pharmacopée de l'époque. A l'intérieur se trouve une grande armoire à tiroirs réservée au rangement des plantes (troisième photo). Les plantes naturelles bien connues des Indigènes sur place, associées à la connaissance et aux techniques occidentales permirent aux colons de mettre au point une pharmacopée nouvelle. D'autres cultures existaient : Celle, bien sûr, de la canne à sucre, mais aussi celle du tabac et celle des perles. Le commerce des perles tenait son origine du Vénézuela. Cette affaire très lucrative pour l'oligarchie espagnole durera toute la première moitié du XVI ème siècle. A partir du second voyage de Christophe Colomb, on troque les perles. Une exploitation organisée se met en place : La perle provenait alors de l'île de Cubagna, était apportée à Saint-Domingue où elle était évaluée, sous-pesée, puis repartait vers Séville (Espagne). L'Espagne servait ensuite de plate forme d'exportation vers le reste de l'Europe. Malheureusement, la pêche trop intensive des perles va voir le nombre d'huitres décroitre sérieusement à partir de 1528, provoquant ainsi une crise durable dès 1537.
Pour terminer cette visite, un petit clin d'oeil ! Comme je redescends du premier étage vers la sortie du musée, je remarque un paon se promenant tranquillement dans les couloirs. Le personnel des lieux m'informe que cet oiseau est la mascotte du musée des Maisons royales. Alors si vous le croisez un jour, évitez de le pousser à la roue !
INFOS PRATIQUES :
|