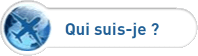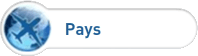Revoir le globe

|
A la Découverte de la Basse-Terre
(Guadeloupe, France) |
|
Mercredi 19 mars 2014
Etant contraint de refaire mon visa US sur mon passeport, j'ai du déposer celui-ci pour quelques jours et ma compagnie m'a affecté un vol sur la Guadeloupe, destination française (une seule carte d'identité suffit).N'ayant que très peu de temps disponible, j'ai heureusement sur place pour cette fois un ami, Xavier (en photo ci-dessous), qui m'offre de faire le tour de la Basse-Terre en voiture, juste avant de repartir vers Paris. L'île de la Guadeloupe est en effet formée de deux parties: la Grande Terre (à l'est) et la Basse-Terre (à l'ouest), d'une superficie de 848 km2. Cette dernière est une région montagneuse non dénuée de charme. Elle est recouverte d'une forêt tropicale très dense du nord au sud où abondent rivières et cascades. Nous partons de l'auberge de la Vieille Tour vers 7h30 dans l'espoir d'éviter les embouteillages. C'est le problème de l'île, où les axes de communications insuffisamment développés et vite limités en capacité sont rapidement engorgés.
Xavier prend la direction de Capesterre-Belle-Eau car il s'est promis de me faire découvrir une spécialité régionale : le kassav' (ou galette de manioc). Nous nous arrêtons aux portes de la petite ville et rencontrons une charmante dame (ci-dessous) très affairée dans la confection de kassav. Cette gourmandise est faite de manioc, une racine dont la culture ne nécessite pas de sols très riches et peut en plus résister à la sécheresse. Le manioc fut introduit en Guadeloupe à l'époque précolombienne. Dans un coin d'atelier, j'observe un antillais qui pèle plusieurs de ces racines. Un autre ouvrier passe ensuite celles-ci dans une grande râpeuse afin d'en faire une pâte qui va servir à confectionner ces galettes, autrefois consommées nature par les indien Arawaks. Aujourd'hui, on les consomme sucrées (garnies de coco, goyave, ananas ou chocolat...) ou salées (chiktaye de morue, viande, saucisse, jambon fromage...). Ce qui est certain, c'est que ce mets vous cale l'estomac pour la journée. Et se conserve aussi deux semaine dans le bac de votre réfrigérateur. A noter que le kassav est meilleur dégusté tiède ! Les galettes, une fois prêtes , sont posées sur la plaque d'un vieux four alimenté par un feu de bois. Une fois cuites, elles sont emballées sommairement puis vendues dans une boutique voisine.
Notre temps est compté et nous ne nous arrêterons pas à Capesterre-Belle-Eau, petite commune traversée par trois principaux cours d'eau : la rivière du Grand Carbet, la Grande rivière de la Capesterre et la rivière du Pérou. Ces trois rivières se rejoignent pour former une embouchure commune avant de se jeter dans l'océan, juste au nord du bourg, près de la pointe de la Capesterre. Nous apercevons au loin, le volcan de la Soufrière (ci-dessous), aussi surnommé « la vieille dame », qui est situé au sud de la Basse-Terre, dans le parc national de la Guadeloupe. Son sommet culmine à 1467 mètres et est le plus haut sommet de l'île et des Petites Antilles. Son dôme de lave prend la forme d'un cône tronqué de 900 mètres de diamètre. Ce volcan ne possède pas véritablement de cratère mais plusieurs bouches éruptives. Sa dernière éruption magmatique remonte à 1440 (date approximative) et sa dernière éruption phréatique date de 1976 : celle-ci conduisit à l'évacuation de la partie sud de la Basse-Terre et près de 74000 personnes durent être évacuées. L'année précédente, plusieurs tremblements de terre avaient eu lieu (16 000 séismes et 26 explosions furent répertoriés entre 1975 et 1977), annonçant l'éruption prochaine. L'activité volcanique se poursuivit durant quelques mois après cette éruption qui occasionna d'importantes coulées de boue qui dévalèrent la rivière du Carbet et la rivière du Galion. Nous n'aurons pas le temps de nous rendre aux chutes de la rivière du Grand Carbet, qui figure pourtant parmi les plus impressionnantes chutes des Petites Antilles. Cette rivière doit son nom au village amérindien, composé de carbets, c'est à dire de grandes cases ouvertes sans abris, lequel était jadis installé non loin de son embouchure. Depuis le parking, trois heures sont nécessaires (pour faire l'aller et retour) afin d'atteindre la première chute (il y en a trois au total).
Sur notre chemin, Xavier me conduit aux bains de montagne de Dolé (ci-dessous). Situés à Gourbeyre, ces bains sont une source thermale qui constitue le seul vestige du passé thermal de cette petite commune. On les trouve au lieu-dit « Le Soldat » dans la localité de Dolé, en venant par la route menant à Trois-Rivières. Le bassin, peu étendu, et d'une profondeur d'environ un mètre, est alimenté par des sources chaudes (30° environ) qui sont captées sur les flancs de la Soufrière. Une cascade d'eau chaude longe le bassin à l'ouest. On prétend que ces bains posséderaient des vertus dermatologiques et anti-rhumatismales. Dolé abrite également une usine d'embouteillage d'eau de source. La commune de Gourbeyre, toute proche, s'appelait autrefois « dos d'âne », à cause du fort dénivelé causé par les formations géologiques du col à cet endroit, mais ce lieu détaché n'avait alors aucune existence communale. Le 8 février 1843, un séisme ravagea l'île en grande partie (dont « Dos d'âne ») et c'est le gouverneur d'alors, Jean Baptiste-Maris Augustin Gourbeyre qui organisa les secours des habitants. Ces derniers choisirent de donner leur commune du nom de ce gouverneur en remerciement de son action, le 30 avril 1846.
Nous nous rendons maintenant à Basse-Terre (la ville) dans l'espoir d'admirer son marché local. Malheureusement, des travaux sont actuellement en cours et le marché a disparu. Située sur la côte sous le vent, au pied du volcan de la Soufrière, cette ville abrite la préfecture, le conseil régional, le conseil général, le diocèse, le palais de justice et la cour d'appel de l'archipel. Le lieu était autrefois un village d'Amérindiens à la fois horticulteurs et potiers, localisé sur le site de l'actuelle Cathédrale N.D de Guadeloupe. En 1635, une expédition cherche un lieu d'implantation durable à la Guadeloupe. Le débarquement a lieu à la Pointe Allègre et la famine poussera les hommes à descendre jusqu'à la Basse-Terre. Charles Liénard de l'Olive n'est pas le bienvenu et une guerre a bientôt lieu entre sa troupe et les Amérindiens. Un embryon de ville est alors bâti. Les Anglais incendieront le bourg de Basse-Terre en 1691, puis en 1703, avant d'occuper la place de 1759 à 1763. L'histoire du lieu est ensuite parsemée de plusieurs razzias anglaises. Et Basse-Terre de souffrir vingt ans durant des séquelles de ces agitations. Subissant aussi quatre puissants cyclones (en 1816, 1821, 1825 et 1844), la ville songe enfin à se réhabiliter en construisant un hôpital militaire, un évêché, et en assainissant et en agrandissant la cité avec des nouveaux quartiers (Trianon, Versailles, Petite Guinée, et Petit Paris). Ce qui n'empêchera pas l'endroit de subir une épidémie de choléra en 1865. L'hôtel de Ville est inauguré en 1889. Puis le Palais de justice, le palais du Conseil Général, et un marché voient le jour dans les années 1930. On construit aussi un port entre 1961 et 1964. C'est là que Xavier et moi nous arrêtons quelques instants afin d'observer le vol des pélicans (ci-dessous).
La prochaine étape sera Bouillante. Sur la route, nous passerons à la pointe de l'Anse (ci-dessous). Là se trouve le phare de l'Anse à la barque, à la limite des communes de Vieux-Habitants et de Bouillante. Il s'agit d'une tourelle cylindrique peinte en blanc, au fond d'une crique bordée de cocotiers, située sur la côte ouest, sur la Côte sous le vente. La mer s'engouffre dans cette anse sur plus de 400 mètres, offrant aux bateaux un refuge privilégié en cas de mauvais temps.Un autre phare existe à l'extrémité nord de l'anse. Les deux fonctionnent et permettent une entrée dans l'anse de nuit. Tout autour, la végétation est luxuriante, le soleil est maintenant haut dans le ciel d'un bleu d'azur.
Au lieu-dit Thomas, quelques kilomètres avant d'atteindre Bouillante, se trouve une source d'eau chaude, surnommée « Fontaine Thomas » qui sort du dessous des rochers sur une plage (ci-dessous). En cette matinée, la petite plage est déjà envahie par une douzaine de visiteurs qui pataugent autour de ce petit bassin, car l'eau est aujourd'hui bien trop chaude pour y plonger plus qu'un orteil. Elle sort en effet habituellement à 70° et les rochers forment une piscine naturelle communiquant avec la mer, à marée haute. Les sources d'eau chaude sortent du sol, chauffées par un processus géothermique, et on en trouve sur les tous les continents. Dans le cas de la Guadeloupe, l'existence, toute proche, du volcan de la Soufrière, n'est certainement pas étrangère à la présence de telles sources. Cette eau chaude ayant une meilleure capacité de dissolution apporte souvent à la surface des éléments dissous comme des minéraux (calcium, lithium, radium...) la rendant ainsi bénéfique compte tenu de leurs propriétés médicinales.
Quelques kilomètres plus loin, en remontant vers le nord, nous traversons la petite ville de Bouillante (première photo ci-dessous) : la commune est notable en raison de la présence de la Réserve Cousteau (sur la deuxième photo ci-dessous, on distingue les îlets Pigeon) à Malendure et de la centrale géothermique de Bouillante, une des principales centrales de ce type en France. La rivière portant le même nom coule dans cette commune formée de hameaux dont les accès débouchent sous la forme d'un chemin sur la route nationale 2. Bouillante est aussi réputée pour son café, son cacao et ses jardins créoles. C'est aussi la capitale guadeloupéenne de la plongée sous-marine. La Réserve Cousteau est quant à elle un espace marin protégé d'environ 400 hectares situé autour des îlets Pigeon, face à la plage de Malendure. C'est en 1959, que le Commandant Cousteau découvrit la beauté des fonds de Malendure et qu'il émit le souhait de faire protéger ce site par la création d'une réserve marine. Réserve que les habitants appelèrent très vite et à titre amical, « la Réserve Cousteau ». On peut y admirer coraux, gorgones, cerveaux de Neptune, éponges, poissons tropicaux, langoustes et tortues marines.
Un peu plus loin, au niveau de Mahaut, Xavier tourne à droite et emprunte la route de la Traversée,ou « route des Mamelles », seule route traversant la Basse-Terre, d'est en ouest. Elle relie ainsi Pointe Noire et l'agglomération de Pointe à Pitre par la montagne, via le col des Mamelles. On y trouve le zoo de Guadeloupe, la Maison de la Forêt et la Cascade aux Ecrevisses (ci-dessous). Cette dernière est accessible par un chemin balisé menant jusqu'à la cascade, avec aire d'observation. On peut même se baigner dans la vasque naturelle creusée dans la pierre. Ce sont, chaque année, entre 200 et 400 000 visiteurs qui se rendent à cet endroit et font ainsi de ce site le lieu le plus visité de la Guadeloupe. Quant aux écrevisses, je n'en ai aperçu aucune mais il semblerait qu'il en existe cinq ou six espèces d'après un panneau d'information situé à l'entrée du chemin balisé. Il faut aimer les virages pour conduire sur cette route de la Traversée, mais le paysage est si beau qu'on oublie vite cet inconvénient, et puis cet axe routier sert en quelque sorte de route de délestage pour ceux qui veulent éviter les embouteillages pour se rendre à Pointe à Pitre... Sur notre chemin, à quelques minutes de la cascade des écrevisses, s'élève le col des Mamelles (deuxième photo ci-dessous). Nous sommes toujours dans le parc national de la Guadeloupe et les Mamelles sont deux pitons : le piton de Pigeon, ou Déboulé, culminant à 768 mètres et le piton de Petit-Bourg (à 716 mètres). Plusieurs randonnées pédestres peuvent être réalisées au départ de la route et vers ce col (des panneaux d'information vous apportent les informations nécessaires).
Nous rebroussons chemin, reprenons cette route de la Traversée pour rejoindre Pointe Noire et nous arrêter quelques instants à la Maison du Cacao (ci-dessous). Située au cœur d'une ancienne région cacaoyère, celle-ci s'attache à vous faire découvrir la saveur originelle du chocolat, de par son savoir faire et ses produits du terroir. Une visite des lieux est possible. Les plus gourmands se contenteront de gouter le chocolat sous toutes ses formes (pâte de cacao,beurre de cacao ou tout simplement, chocolats). Rappelons que le cacao nous vint d'Amérique centrale et d'Amérique du sud, vers 2000 avant J.C, lorsqu'il fut découvert par les Mayas. Le cacaoyer pousse sous un climat dont les températures ne descendent jamais en-dessous de 18°.
Il est une ville qui a vu naitre l'Enfant Jésus (je veux bien sûr parler de Xavier!) : Deshaies, petite commune de la Guadeloupe, est connue pour ses célèbres cases créoles, blotties au fond d'une baie protégée par la montagne (ci-dessous). Elle tient son nom d'un homme nommé Des Hayes, natif du milieu du XVII è siècle, lequel donna son nom à la rivière et à l'anse où s'installa le bourg. Le nom de Deshaies, lui, vient d'un militaire, Albert Deshaies, originaire de Marie-Galante. La commune de Deshaies est aussi tristement célèbre suite au crash d'un avion d'Air France, qui survint en 1962. Cette année-là, un Boeing 707 s'écrasa dans la partie caféière de Deshaies, faisant 113 victimes dont le député de Guyane, Justin Catayée, et l'écrivain gaueloupéen, Paul Niger. C'est le plus grave accident aérien de l’île. La commune vit surtout du tourisme, avec, entre autre, son village du Club Med. Coluche, lui aussi, avait une maison qui donnait sur la baie de Deshaies. L'endroit est aujourd'hui devenu un parc botanique. Robert Charlebois, lui, posséda à la même époque une demeure du côté de la plage de la Grande Anse, la plus grande plage de la Guadeloupe. Sur place, on peut bien sûr visiter le parc botanique, le jardin des Orchidées et cette fameuse plage.
Xavier et moi achevons notre rapide tour d'horizon par la visite d'une résidence particulière : celle-ci offre à ses hôtes de résider dans des bungalows perchés dans des arbres, dans des cases créoles ou dans la Maison de maitre perchée (deuxième photo). La vue est garantie imprenable (photo ci-dessus) et le silence est aussi au rendez-vous. Seul le chant des oiseaux, le son d'une cascade et le bruissement des feuilles viennent bercer votre séjour. Il faut dire que le site sur lequel se trouve cette résidence est exceptionnel, puisqu'il permet de profiter de la nature vierge de la Basse-Terre, au milieu de la forêt tropicale du Moine Bois d'Inde, avec vue sur la mer des Caraïbes. Ne cherchez pas la télévision, il n'y en a pas. Vous profiterez tout de même d'une connexion internet mais c'est tout. Les espaces à vivre sont reliées par des passerelles, qui conduisent, entre autre, à la piscine ou à la table d'hôtes. Dans l'écolodge TendaCayou, la détente est de rigueur et vous repartirez d'ici, requinqué par l'air marin, détressé et reposé. Avis aux amateurs !
INFOS PRATIQUES :
|