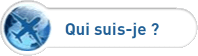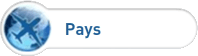Revoir le globe

|
L'ïle de Saint-Martin et le Fort Louis
(Caraïbes, France) |
|
Samedi 26 juillet 2014 Il y a trois ans, je me rendais déjà sur cette île de Saint-Martin, et j'en ramenais quelques photos. Territoire français situé dans la partie nord de l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, Saint-Martin est désormais une collectivité d'outre-mer depuis sept ans. Les Saint-Martinois (habitants de cette ville) subissent toutefois directement une influence nord américaine car, après tout, les Etats-Unis ne sont pas si loin. L'anglais, et même le hollandais, est parlé sur place, d'autant plus que la partie sud de cette île est « occupée » par les Pays-Bas et constitue depuis 2010 l'un des quatre Etats du Royaume néerlandais. L'histoire de cet endroit est fort ancienne puisqu'on relève déjà de la présence humaine sous l'ère précolombienne : amérindiens des Antilles, les Arawaks étaient rattachés à la culture saladoïde (le nom provient du site vénézuélien de Saladero) et leur dénomination désigne une famille linguistique à laquelle se rattachent plusieurs populations amérindiennes d'Amazonie dont les populations Kali'na ou Caraïbes. Ces Arawaks vécurent sur l'île de Saint-Martin (je vous en avais déjà parlé dans un autre article). La période coloniale, elle, s'étendra de 1600 à 1899. A partir de 1624, on sait que les Français s'installent sur l'île afin de cultiver le tabac. Ces Français-là sont les descendants des 80 Français rescapés d'une expédition en Guyane qui fut conduite par le lyonnais Henri de Chantail, alors réfugiés sur l'île voisine de Saint-Christophe. Deux ans plus tard, le capitaine Pierre Belain, sieur d'Esnambuc, accompagné de son associé rouennais Urbain de Roissey, sieur de Chardonville, alors sous les ordres du Cardinal de Richelieu, créent la Compagnie de Saint-Christophe, qui sera chargée d'établir une colonisation française dans cette partie du monde. En septembre 1629, les Français arrivent à Saint-Martin après avoir été attaqués à Saint-Christophe par les Espagnols. Cette première compagnie sera remplacée par la Compagnie des îles d'Amérique à partir du 12 février 1635. Quelques Français cultivent déjà le tabac sur place. En 1648, l'île de Saint-Martin passe sous contrôle de la colonie française de l'île Saint-Christophe. Et les accords de Concordia sont signés entre Français et Hollandais. Ils précisent les conditions d'occupation, de souveraineté et de partage de l'île Saint-Martin aux petites Antilles après le départ des Espagnols, en permettant une libre circulation des biens et des personnes sur l'ensemble de l'ile. Mais ce traité n'empêchera pas la survenue d'autres évènements. Les Anglais occuperont l'endroit de 1672 à 1679, donnant lieu à la Guerre de Hollande. En 1676, une escadre néerlandaise attaque l'île par la baie de la plage orientale et 1200 soldats ravagent la partie française. Les Français ne seront pas tout de suite au bout de leur peine, car les Anglais les déporteront sur l'île Saint-Christophe en 1689. Nos compatriotes ne seront autorisés à revenir sur l'île qu'en 1697 suite au Traité de Ryswick.
En 1703, le Gouverneur de Saint-Eustache chasse les Français. A l'époque, le Gouverneur français de l'île de Saint-Christophe, Longvilliers de Poincy, et le Gouverneur de Saint-Eustache, Abraham Adriensen, cherchent à établir leur autorité sur l'île de Saint-Martin. Et les îles de Saint-Eustache, une partie de l'île de Saint-Martin et Saba de passer sous le contrôle direct de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, en 1678. En 1706, un corps expéditionnaire français reconquiert l'île de Saint-Martin. Puis la construction du Fort Louis interviendra plus tard à Marigot (qui reste encore aujourd'hui la ville la plus important de la partie française de l'ile) sous l'impulsion du chevalier de Durat, gouverneur de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Ce fort (en photo ci-dessus) dominera la ville et la baie, et sera, dit-on, à l'origine conçu pour défendre les entrepôts du port de Marigot où se trouvaient les produits stockés par les habitants (sucre de canne, café, rhum et sel) contre les attaques anglaises et des flibustiers. Entre temps, plusieurs raids dus aux Anglais d'Aguila se produiront dans la région de 1756 à 1763. En 1765, le chevalier Descoudrelles organise la défense de la petite ville de Marigot et fait installer trois batteries de canons en trois endroits névralgiques : une batterie sur la falaise de la Pointe Bluff, une autre sur le Morne rond et une autre sur le Morne de Marigot. Ce qui n'empêchera pas l'ile de Saint-Martin d'être occupée par les Britanniques à plusieurs reprises jusqu'en 1796 (ceux-ci s'empareront alors du Fort-Louis), date à laquelle Victor Hugues, arrivant de Guadeloupe, refoule ces derniers. Le commissaire de la République, Pierre-Charles Dormoy, séquestre ensuite les biens appartenant aux Britanniques avant...d'épouser la plus riche propriétaire. Dès le début du XVII è siècle, quelque familles françaises s'étaient déjà installées à la pointe Nord du grand étang de Simpson Bay. L'endroit avait aussitôt été nommé « Marigot » à cause des marécages et de la mangrove qui bordaient cet étang. Les Français cultivaient le tabac, le coton et l'indigo, malgré le fait que leurs récoltes étaient souvent pillées ou détruites par les incursions anglaise ou par les Flibustiers. Le Chevalier Descoudrelles, qui devint Commandant des iles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy en 1764, permettra enfin d'envisager un développement durable de ce qui était devenu le petit bourg de Marigot, notamment en mettant en place plusieurs lignes de défense décrites plus haut. Le Chevalier a aussi compris l'intérêt et la commodité de cette belle baie située dans la partie nord-ouest de Saint-Martin, dans laquelle de gros bâtiments peuvent aisément mouiller. Le Morne inaccessible de Marigot avait déjà été repéré comme lieu stratégique de défense de la baie. Ce n'est pas le Chevaliers Descoudrelles qui concrétisera son projet de défense mais son successeur, le Chevalier de Durat : celui-ci érigera le Fort-Louis à partir de 1784, en accord avec les habitants des lieux. Le plan leur fut en effet proposé et c'est en quelques minutes de délibération seulement, et d'une voix unanime, que les habitants souscrivirent au projet et fournirent les moyens de sa réalisation. Monsieur de Durat choisit de nommer ce fort, Fort-Louis, tandis que les habitants baptisèrent son pont du nom de Durat. Quelques mots gravés dans une pierre de taille placée au centre du parapet du pont témoignait de la chose. Pierre malheureusement détruite par les Républicains au moment de la Révolution. A noter que la caserne des pompiers ainsi que le petit pont de Durat (qui existe toujours au Hameau du Pont) furent achevés à la même date que le Fort-Louis, soit 1789.
En 1821, un certain Monsieur Philibert, chef de bataillon de directeur des fortifications proposera de construire un magasin à poudre car, entre temps, les incursions anglaises n'avaient pas cessé. Déjà, en 1808, dès l'aube, le Fort Louis avait été attaqué par 200 hommes, tous matelots et gardes marine d'une flotte anglaise arrivée là. Une heure après leur débarquement, les Français avaient déjà brillamment contre-attaqué, tuant certains assaillants et faisant fuir les autres. Certains furent faits prisonniers. A ce moment-là, la garnison du fort était formée de 28 militaires (y compris le Commandant des lieux) et de 15 miliciens. Une incursion hollandaise aura aussi lieu, destinée à se procurer le café abrité dans le Fort-Louis. Une nouvelle occupation anglaise aura lieu de 1810 à 1815. Le traité de Paris de 1816 permettra à la France de récupérer la partie française de l'ile et c'est alors le régime juridique guadeloupéen qui y sera appliqué. 1848 verra la seconde abolition de l'esclavage, qui était déjà pratiquée de fait dans la partie française de l'ile Saint-Martin. Les premières salines sont créées à la même époque. Mais l'ile souffre toujours d'un cruel manque de ressources et deux ans plus tard, le Conseil privé de Guadeloupe décide d'octroyer à la petite île de nouvelles immunités commerciales, ainsi que de nouvelles faveurs dans le but d'encourager l'exploitation des salines. Et l'ile de Saint-Martin de bénéficier du statut de port-franc, où les droits de douane ne sont pas perçus. Mais rien n'y fait : fin XIX è, l'économie de l'ile somnole de plus en plus malgré des productions de qualité (bovins, sel, coton et rhum).
Le gouvernement se désintéresse alors pour un temps de ce petit bout de terre antillaise, sauf lorsqu'il s'agit d'y récupérer des soldats pour aller combattre sur les fronts des deux guerres mondiales. Les jeunes partent alors travailler pour l'industrie pétrolière à Curaçao, sur l'ile de Saint-Domingue pour la canne à sucre, aux Iles Vierges américaines ou aux Etats-Unis. La partie française de l'ile passe sous le régime de Vichy de juillet 1940 à août 1944. L'ile deviendra une sous-préfecture en 1963 et verra l'apparition de l'électricité. Le premier établissement bancaire à ouvrir ses portes sur l'ile sera la Crédit Agricole. Deux ans plus tard, Saint-Martin connaitra le début de l'industrie touristique, mais également la construction de sa première usine de dessalement. L'aéroport de Grand-Case ouvrira quant à lui en 1972. Depuis l'ile est toujours partagée entre les communautés française et hollandaise. Et la partie française de naviguer entre dévastations (cyclones), dépressions économiques et lois de défiscalisation. INFOS PRATIQUES :
|